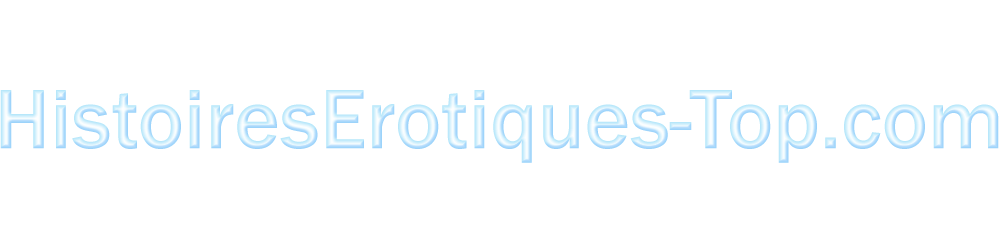Toute petite, toute menue, toute gentille, toute fluette, docile, travailleuse, jolie, espiègle, bonne copine, fêtarde, généreuse, à l’écoute, sans vice, câline, coquine, elle avait tout ce qu’il rêvait de détruire. L’emprise qu’il avait sur elle était totale, massive, brutale, exclusive et délétère. Elle en a subi des humiliations, des brimades, des coups, et pourtant elle l’aimait à s’en oublier, à tout lui pardonner, à espérer qu’il change, qu’il redevienne le gentil garçon qui lui avait fait si assidûment la cour avant de la mettre dans son lit et de lui passer une bague au doigt.Dix années d’un interminable calvaire, durant lesquelles les éclaircies étaient rares mais si rassurantes. Parfois, quand il était tout proche de l’ultime outrage, il se faisait à nouveau gentil et prévenant. Il pansait les plaies de sa victime consentante, l’embrassait, la complimentait, la dorlotait, se confondait en sincères excuses ; alors elle craquait à nouveau, lui redonnait sa confiance, acceptait sa contrition, lui ouvrait ses bras et ses cuisses. Ils faisaient l’amour tendrement, longuement, passionnément. Mais dès le lendemain, sans trop qu’elle sache dire pourquoi, il rentrait en colère, balançait ce qui lui tombait sous la main, l’insultait, la traitait de tous les noms, puis il la prenait par les cheveux, la traînait au sol, lui arrachait ses vêtements et l’obligeait à le satisfaire pour faire baisser la pression. Il lui imposait sa grosse bite et ses doigts, la prenait sans ménagement comme une poupée de chiffon. Elle se laissait faire, convaincue que l’orage allait passer, puis une fois la pression retombée, elle se cachait pour pleurer.Il est mort comme un con, comme il a vécu. Ivre au volant, il a raté un virage et percuté un convoi agricole de plein fouet. Heureusement, le chauffeur n’a pas été blessé, physiquement en tout cas. Et Marlène s’est retrouvée seule avec son chagrin, avec ses regrets, avec le sentiment que sa vie était terminée, et que c’était tant mieux, tellement sa vie était moche, tellement sa vie était triste. Elle n’avait plus d’amis, plus de relations sociales, et même plus de travail. Elle n’avait que ses souvenirs de souffrances, ses souvenirs de femme violentée, ses souvenirs de femme de rien.La tristesse s’est muée en mélancolie, puis tout doucement c’est devenu de la colère. De la colère contre lui, et de la colère contre elle-même. De la colère contre les gens, contre tous ceux qui n’avaient rien vu, contre tous ceux qui n’avaient pas aidé son mari à redevenir bon, qui ne l’avaient pas aidée, elle, à l’aider, lui. Enfin, de la colère contre la terre entière.Quand j’ai rencontré Marlène, ça faisait 3 ans qu’elle était seule, 3 ans qu’elle déclinait, qu’elle ne s’occupait plus d’elle-même ni de personne, 3 ans qu’elle n’avait pas fait le ménage chez elle, 3 ans qu’elle n’était pas allée chez le coiffeur ou chez l’esthéticienne. Son défunt mari avait réussi à la tenir encore sous son emprise en lui laissant une assurance-vie confortable, dont elle ignora l’existence, d’ailleurs, jusqu’à ce que l’assureur la contacte. Elle se laissait aller doucement vers la mort. Elle était déjà morte socialement ; il ne restait plus qu’à laisser son corps fondre, en essayant de souffrir le moins possible. Plusieurs fois, elle avait envisagé de se jeter dans la Seine ou sous un train, ou de prendre des médicaments pour dormir toujours, mais quelque chose l’avait retenue, la peur peut-être, l’espoir sans doute pas.Un soir elle a sombré, et ce sont des passants qui ont alerté le SAMU. Elle a été prise en charge par le centre hospitalier qui l’a transférée, après les premiers soins, vers une unité spécialisée dans les cas pathologiques.Elle ne m’a raconté son passé que très longtemps après notre première rencontre, quand enfin elle m’a fait confiance, quand enfin elle a compris que nous n’étions pas, nous, les hommes, tous comme celui qu’elle avait aimé et haï.C’était un samedi matin, il devait être 3 heures tout au plus. Je rentrais de boîte avec des amis. J’étais Sam, celui qui ne boit pas. Le ciel était d’un noir d’encre, et la pluie tombait en cordes. Je roulais au pas quand j’ai vu quelqu’un s’écrouler sur le trottoir. Une forme tout juste humaine, qui a visiblement heurté un obstacle du pied et qui, déséquilibrée, a chuté sur la route. Naturellement, je me suis arrêté pour proposer de l’aide, avant de l’entendre m’insulter de sa petite voix fluette.Elle était sale comme un peigne, trempée comme une soupe, craintive comme une chatte. Je lui ai proposé un manteau, qu’elle a d’abord refusé avant que je ne lui pose sur les épaules. Je ne savais pas comment l’aider au-delà. Elle ne donnait clairement pas envie qu’on s’approche d’elle, mais quand j’ai vu ses yeux noirs, j’ai ressenti une émotion venue de nulle part, et oublié tout le reste. La laideur de cette femme était anachronique. Elle est partie en courant, mon manteau pour la protéger, et je l’ai perdu de vue.Je ne vous raconte pas les commentaires de mes amis une fois remonté dans la voiture. J’ai eu droit à tout. Ils se marraient en me disant que j’aimais les clodos, que je bandais pour les crados, et j’en passe. Mais moi, j’avais encore ses yeux devant les miens. Les yeux de la bonté, de la douceur. Ça n’allait pas avec le reste.Quelques jours plus tard, j’ai reçu un appel sur mon portable. C’était l’hôpital central. Une femme avait été trouvée inanimée dans une ruelle, porteuse d’un manteau dans lequel ils avaient trouvé une carte de visite m’appartenant. Ils avaient pensé que peut-être je la connaissais, que peut-être elle m’avait volé mon manteau, et en tout cas ils n’avaient rien trouvé d’autre pour l’identifier.Je n’y pensais même plus à cette femme qui m’avait troublé et ému. Mais ce fut tellement bref, tellement furtif. J’ai dit à mon interlocutrice que je ne la connaissais pas, qu’ils pouvaient garder le manteau, et j’ai raccroché.Je suis entrepreneur. Précisément, je dirige une petite entreprise qui intervient dans l’installation de chauffages collectifs, de climatisations, de ventilations, et de distribution d’eau. Le plus souvent, je travaille sur des marchés publics, et à cette époque j’étais principalement occupé sur le site de l’annexe psychiatrique de l’hôpital. C’était un corps de bâtiment assez ancien dont nos étions en train de refaire tout le chauffage, et que nous traitions par zones.C’est là que j’ai rencontrée à nouveau cette pauvre femme. Je ne l’ai pas reconnue tout de suite, d’ailleurs. Elle faisait sa promenade dans le parc, l’air pensif, accompagnée d’autres patients tout aussi perdus. Cette annexe est en réalité plus une maison de repos qu’un asile. L’hôpital y fait passer quelques jours ou quelques semaines à ses patients qui en ont besoin, après une dépression par exemple.Je passais moi-même dans le parc au volant de ma camionnette en faisant surtout attention à rester discret, quand j’ai croisé son regard. Ce n’était plus la même femme ; c’était pourtant le même regard, troublant. J’ai mis quelques secondes à réaliser que je la connaissais, en tout cas que je l’avais déjà vue. Au mince sourire que j’ai cru apercevoir sur son frêle visage, j’ai compris qu’elle aussi m’avait reconnu.Après avoir garé mon engin à l’endroit du chantier, je suis revenu vers elle pour la saluer. C’est l’image d’un chat qui m’est apparue quand je lui ai tendu la main, un chat craintif qui a dessiné autour de lui un périmètre de sécurité qu’il ne vous laisse pas pénétrer. La peur se lisait sur son visage, une peur viscérale contre laquelle elle semblait lutter, convaincue sans doute que je ne lui voulais pas de mal. Quand elle a prononcé son prénom, j’ai su. J’ai su que je ferais tout pour l’apprivoiser, la connaître, en faire une amie. Dans sa blouse blanche semblable à toutes les autres dans ce parc, elle était cadavérique, émaciée, faible et tremblante, mais moi je l’ai trouvée belle, une belle âme perdue, une âme tourmentée mais belle, et tout ça c’était dans son regard.Mon chantier a pris du retard, mais je n’en avais cure. Quand je partais de chez moi le matin, je n’avais qu’un objectif : la croiser dans le parc, l’inviter à s’asseoir sur un banc, parler avec elle, la faire parler, la regarder, et surtout recevoir son regard dans le mien, sentir les vibrations qu’il provoquait en moi, au plus profond de moi, la garder le plus longtemps possible. Puis quand la fin de la promenade arrivait, je repartais travailler, triste de la quitter, en pensant à demain, en pensant à la revoir, en pensant à elle.Je ne savais que peu de choses malgré le temps passé avec elle. Marlène ne se livrait pas facilement, mais sa confiance que je m’attachais à obtenir petit à petit l’avait conduite à s’ouvrir un peu, doucement, pas à pas. J’aurais voulu rester avec elle, là, sur le banc, des heures durant. Qu’elle me parle d’elle, de ses souvenirs, de ses envies, de ses projets, d’elle.Puis un jour elle m’a annoncé une bonne nouvelle pour elle : les médecins allaient la laisser sortir. Son sourire était triste quand elle a dit « bonne nouvelle », comme si la nouvelle n’était pas aussi bonne que ça. Elle a consenti à me dire que nos rencontres sur le banc allaient lui manquer, qu’une fois chez elle sa tristesse et sa solitude seraient ses seules compagnies. J’ai pris sa main dans la mienne quand j’ai vu une larme couler sur sa joue, et je lui ai promis qu’on se reverrait. Un ange est passé, ce jour-là.Le soir même j’ai composé le numéro fixe qu’elle m’avait laissé. J’ai dû rappeler plusieurs fois avant qu’elle ne décroche. Je voyais son image en blouse blanche, ses yeux tristes, et je sentais sa main froide en entendant sa voix devenue un peu caverneuse. Nous nous sommes parlé longuement, plusieurs jours de suite, mais elle ne voulait pas qu’on se voie, elle ne voulait pas s’attacher, elle ne voulait pas que je sache où elle vivait ; elle ne voulait que garder un lien comme celui-là, distant, froid. Et j’ai accepté, convaincu qu’un jour je viendrais à bout de ses réticences et qu’enfin elle m’ouvrirait son cœur. J’étais amoureux. Je le savais, au plus profond de moi, mais le lui dire m’était impossible tellement je me sentais ridicule.Elle a fini par accepter qu’on se rencontre, en ville, un midi. Sur la place principale je me suis assis sur un banc, le banc vers lequel nous étions convenus de nous retrouver. Et je l’ai attendue, patient, heureux déjà, euphorique presque. Marlène est apparue, toujours mince et fine mais plus vraiment maigre. Son teint s’était éclairci et sa démarche assurée. Un sourire tout neuf ornait son petit visage devenu tout mignon, mais son regard était le même, profond et sensible.On devait avoir l’air malin tous les deux à nous regarder, distants de deux mètres, avec nos sourire de benêts, comme deux ados qui n’osent pas s’approcher. J’avais peur de faire un pas vers elle et qu’elle s’enfuie. Elle avait sans doute peur de me montrer qu’elle avait envie de mes bras. Alors je me suis rassis, et j’ai désigné la place libre à côté de moi pur qu’elle me rejoigne.Côte à côte, nous avons repris nos conversations du parc, ou plus exactement elle a repris l’évocation de ses souvenirs douloureux. Et j’ai compris. J’ai compris sa vie, sa détresse, sa peur de l’autre, sa dépression, ses angoisses. J’ai compris la confiance qu’elle avait en moi pour se confier ainsi, pour me montrer sa fragilité et ses doutes. Nous sommes restés ainsi plusieurs heures, sans voir le temps passer, à nous confier l’un à l’autre. J’ai pris sa main, qu’elle ne m’a pas refusée, puis je l’ai attirée vers moi pour qu’elle pose sa tête sur mon épaule, pour lui montrer que je la soutiendrais dorénavant, que je serais volontiers un socle solide pour elle, quoi qu’il advienne. Je me suis senti heureux d’être là, avec elle, sur cette place bruyante. Il n’y avait pas de plus bel endroit.Nous nous sommes ensuite revus régulièrement, sur la place, dans un bar, dans un restaurant, dans un parc. Je n’osais pas aller au-delà, l’inviter chez moi de peur qu’elle ne s’enfuie, lui proposer de l’accompagner chez elle de peur qu’elle ne refuse. Son mari lui avait fait tellement de mal que je ne voyais pas comment un jour elle pourrait accepter de s’offrir sans retenue à un autre homme, mais j’espérais qu’elle le ferait un jour, à moi.Finalement, c’est Marlène qui a fait le premier pas, sans avoir préparé quoi que ce soit. Je venais de lui annoncer que je serais absent une semaine entière parce que mon prochain chantier était à près de 200 kilomètres. Elle a d’abord gardé le silence un moment avant de se coller contre moi, comme pour m’inviter à la prendre dans mes bras. Je l’ai serrée ; j’étais tellement heureux qu’elle m’offre ce moment. Elle m’a confié sa tristesse à l’idée de ne pas me voir pendant si longtemps, et aussi son bonheur de me voir chaque jour. Elle m’a confié qu’elle adorait nos rencontres, qu’elle n’avait jamais eu un ami tel que moi. Pour elle, nous étions des amis, des amis si proches qu’elle n’avait eu aucune pudeur à me parler d’elle, à me parler de son passé, des ses effrois, de ses angoisses. Puis sa voix est devenue inaudible, comme un murmure dans mon cou. Je savais qu’elle parlait, je sentais son souffle sur ma peau, je sentais ses bras autours de mon torse, puis j’ai senti la peau de sa joue, sa bouche qui m’embrassait, des frissons dans tout mon corps. Elle venait de me dire qu’elle ressentait quelque chose de très fort pour moi, mais ce qu’elle ressentait, elle ne voulait pas me le dire vraiment ; elle voulait que je le sente, que je ressente.Nous sommes restés ainsi, debout au milieu des gens, à nous avouer sans nous parler qu’entre nous il y avait peut-être un attachement qui allait au-delà de l’amitié, que pour être sûrs de ne pas perdre cette amitié qui nous liait nous n’étions pas prêts à nous dire vraiment le fond de nos pensées.C’est elle qui m’a offert ses lèvres en remontant son visage vers moi. Nous nous sommes embrassés, avec une tendresse que j’imaginais impossible. Et ce soir-là, elle n’est pas rentrée chez elle. Nous avons marché comme des gamins heureux jusqu’au premier hôtel, gravi les escaliers en sautillant, ouvert la porte avec détermination. Et une fois seuls, nous sommes encore restés longtemps serrés l’un contre l’autre, à nous embrasser, à se regarder dans les yeux, à profiter de nous, sans un mot parlé, avec seulement des messages qui passaient par le souffle, par la peau, par les baisers.Petit à petit elle m’a offert sa peau contre la sienne en ouvrant son corsage sur ma chemise déboutonnée. Nous avions peur l’un et l’autre de rompre le charme, que tout s’arrête sur une maladresse. Mais il fallait bien qu’une initiative soit prise, que l’un ou l’autre offre ou demande quelque chose de plus, qu’une main se décide enfin à partir à l’aventure. Eh bien j’étais ce jour-là incapable de faire quoi que ce soit d’autre que ce qu’elle me demandait, satisfait, déjà, de la tendresse infinie qu’elle m’offrait.C’est Marlène qui a quitté son corsage en me regardant dans les yeux, puis qui a dégrafé son soutien-gorge avant de le jeter sur le lit. C’est elle qui a pris mes mains pour les poser sur ses petits seins, m’invitant à la caresser. C’est elle qui a déboutonné sa jupe et l’a laissé tomber au sol, elle aussi qui a fait rouler sa culotte à ses pieds pour se montrer nue devant moi, fragile comme de la porcelaine, chétive presque, mais tellement désirable.C’est elle qui a fait tomber ma chemise puis mon pantalon, qui a baissé mon boxer, puis qui s’est collée contre moi pour m’embrasser. C’est elle qui m’a attiré vers le lit et s’est allongée devant moi, les bras ouverts pour que je la rejoigne. J’avais tellement envie d’elle, de la couvrir de baisers, de la cajoler, de la dorloter, de la caresser, de la lécher, et j’avais tellement peur aussi de la briser, de lui faire mal, d’être maladroit. Je suis assez carré et lourd, elle est petite et frêle. Je suis musculeux et patiné, elle est toute minuscule. Quand je me suis allongé sur elle, j’ai eu peur de l’écraser tellement notre différence de gabarit est importante.Sa petite main est venue chercher ma verge pour la guider vers elle, vers son intimité étroite et chaude qui voulait m’accueillir. Je l’ai laissée me guider, descendre vers moi. Sa main me caressait en même temps qu’elle poussait pour me prendre tout doucement en elle. La tête en arrière, concentrée, décidée, elle s’est tout doucement adaptée à la taille de mon sexe pour qu’enfin je voie tout en elle. J’aurais pu la broyer, la défoncer, la briser. Je ressentais un tel amour pour cette toute petite femme qu’au contraire je me suis attaché à rester tendre, à la prendre comme on prend une déesse, pour lui donner mon cœur, lui donner mon âme. Nous avons fait l’amour si tendrement, si tranquillement, comme des amis qui se veulent du bien.Elle est devenue petit à petit plus vorace, plus dynamique, plus salope. À mesure que notre relation s’est installée, que sa confiance en moi s’est confortée, nous avons atteint un niveau de complicité incroyable. La voir aujourd’hui heureuse fait mon bonheur, même si parfois je sens encore en elle des pointes de mélancolie quand elle repense à son passé.Quand elle me parle de son passé, des coups que lui mettait son mari, je sais qu’ensuite je la prendrai dans mes bras pendant qu’elle pleure, que je la rassurerai, que nous dormirons dans les bras l’un de l’autre, qu’elle n’aura pas envie de faire l’amour et moi non plus. Je sais qu’au réveil, ou même en pleine nuit, je sentirai sa petite bouche se saisir de mon sexe. Je sais qu’elle viendra à genoux entre mes cuisses et qu’elle me sucera, une main passée entre ses cuisses pour se masturber, puis qu’elle viendra sur moi, qu’elle me prendra en elle en m’embrassant et en me disant qu’elle m’aime, qu’elle ira et viendra sur ma queue tendue jusqu’à s’inonder de mon plaisir, qu’elle jouira en me griffant, et que nous nous endormirons sans nous séparer. Je sais qu’un peu plus tard je viendrai lui apporter le petit-déjeuner, qu’elle prendra le plateau pour le poser au sol, et qu’elle m’attirera vers elle pour faire l’amour à nouveau.Les violences qu’elle a subies lui reviennent de moins en moins en mémoire à mesure que nous nous construisons nos propres souvenirs communs, des souvenirs de bonheur, de joie, de complicité. Marlène me demande de plus en plus souvent de la prendre plus brutalement, de la secouer, d’abuser d’elle. Elle voudrait que je prenne moins de précautions, que je me lâche un peu. Mais j’avoue avoir un peu de mal. J’ai toujours peur de lui faire mal, de me comporter comme son ex.Récemment, j’étais arrêté à un feu en rentrant d’un chantier quand j’ai vu que j’avais un SMS. Au parking suivant, j’ai fait une pause pour lui répondre.« Chéri, tu penses rentrer à quelle heure ? »« Vers 18 heures, comme prévu. Je suis dans les temps. Il y a une urgence ? »« Oui. C’est urgent : j’ai envie de toi. »« Wow ! Tu peux compter sur moi. Moi aussi j’ai hâte de te faire l’amour. »« Rentre vite. J’ai envie que tu me baises ce soir. »« Baises ? J’ai bien lu ? »« Tu as bien lu, oui. J’ai une grosse envie de me faire baiser. »« Marlène ? C’est toi qui écris ça ? »« J’assume. »« J’arrive. »J’ai gambergé en roulant. C’était la première fois qu’elle parlait comme ça.Et elle disait vrai. C’était un jour particulier ; elle était décidée. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, pourquoi à ce moment-là, et je dois avouer que je n’étais pas particulièrement à l’aise. Ce n’est pas que l’idée de défoncer une nana me soit désagréable. J’en ai baisé, des filles, mais c’est une femme que j’aime et que je respecte plus que tout, alors je n’étais affectivement pas très à l’aise.Elle a voulu que je la prenne à quatre pattes, que je la tire par les cheveux en même temps, que je lui dise des mots crus, que je la traite de salope. Elle aurait voulu que j’oublie à quel point je l’aimais pour la baiser comme une pute, que je profite de sa chatte offerte, de sa bouche gourmande, que je « crache ». Si c’était compliqué au début, le plaisir qu’elle semblait prendre à ce traitement débridé m’a un peu libéré. Je n’ai pas pris autant de plaisir que dans nos ébats « classiques », mais elle oui. Ça se voyait. Elle n’avait jamais joui aussi fort et aussi souvent avec moi avant ça. Elle avait besoin de ça, de se sentir possédée avec force, avec « virilité », sans tendresse, sans égards, juste avec l’intention de profiter de son cul.Nous avons eu une longue conversation après, une fois apaisés. Marlène s’est confiée à moi sans pudeur, sans faux-semblants. Elle m’a avoué qu’elle repensait parfois à son ex-mari. C’était évidemment un connard fini, mais elle repensait quand même aux bons moments qu’ils avaient eus ensemble, et finalement elle m’avait demandé ce jour-là de la prendre de cette façon parce qu’à chaque fois qu’elle se revoyait avec son mari violent dans ces moments de baise, des émotions positives ressortaient. Il y avait une partie de lui qui lui manquait. C’était dur à entendre, mais sincèrement j’ai été très honoré qu’elle soit aussi honnête avec moi, que sa confiance en moi soit si totale qu’elle accepte de se livrer ainsi.Maintenant je sais. Je sais quand elle a envie de tendresse, et quand elle a envie d’autre chose. Dès que j’entends un mot un peu cru dans ses propos, je sais ce qu’elle veut. Elle n’a pas besoin de demander. Je sais qu’elle aimera tout ce que je lui ferai. Je n’éprouve aucun plaisir personnel à être brutal, mais à la voir ainsi jouir sous mes assauts m’excite terriblement. Je préfère les mots d’amour, les longues caresses, les papouilles, la dentelle, le plaisir qui monte tout doucement, l’extase longue et suave, douce et tendre. Elle adore ça aussi, et c’est pour nous un moment de communion intense. Mais elle aime aussi être défoncée comme une traînée, baisée avec fougue, insultée, épuisée par les orgasmes.Nous serons bientôt parents, enfin. Je crois savoir à quel moment notre enfant a été conçu. Je lui disais à l’oreille que je l’aimais, et elle me répondait qu’elle m’adorait. Elle pouvait sentir ma semence au plus profond d’elle, et mon amour pour elle couler en même temps. J’espère qu’un jour elle oubliera ses souffrances.