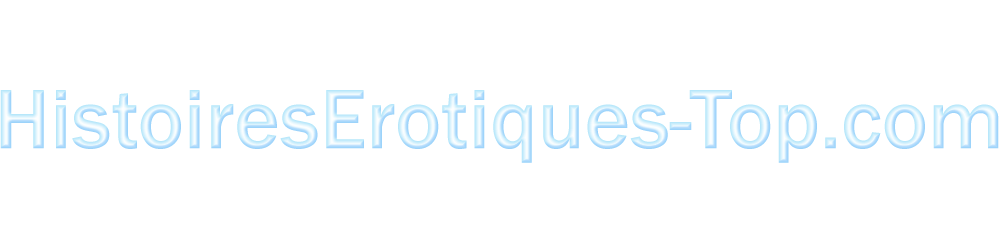Caracas le 30 janvier 1985Chère Mâ,C’était bien sympa de t’avoir au téléphone hier tout comme les petits paquets qui m’attendaient régulièrement à Fort-de-France. Tu sais que la carte postale, la photo souvenir, la babiole ne sont pas mon fort, aussi tu ne m’en voudras pas d’avoir vécu ces trois semaines merveilleuses dans les Antilles sans toucher la plume.Mais les souvenirs sont bien plantés dans ma tête et quelques notes journalières viennent m’appuyer pour entamer le récit style journal de bord que je te dois. Tu n’y perdras pas au change.Tu as paru surprise, voire inquiète, à l’annonce de ma récente démission du Gazebo, pourtant je crois qu’après quelques explications tu suivras le cheminement de ma pensée et tu comprendras ma décision.Après six mois de visa touristique, il m’a fallu solliciter le «Transeunte», c’est un des visas qui permet de travailler légalement pendant un an au Venezuela.Mon patron, Robert Provost, qui nage dans les eaux merdiques de relations d’une faune corrompue s’est chargé de la tâche, moyennant invitation au Gazebo, en m’expliquant que nul ne peut obtenir ce visa sans relations et autres genres de magouilles.Au 1er octobre dernier, je lui remets donc mon passeport, confiant.Dans ce pays, il n’est pas question de sortir sans papiers, surtout pour un étranger.Le risque de se retrouver en taule est trop grand. J’ai dû passer dix jours sans sortir du Gazebo. Puis, en trépignant, j’ai obtenu un laissez-passer au moins pour circuler dans la ville. Ce papier était renouvelable de trois semaines en trois semaines.À chaque fois, il me fallait réclamer ce droit de circuler, de sortir, qui chez nous est primordial. Mon âme rebelle a bien mal accueilli cette situation, me faisant rejeter jour après jour la politique de ce pays. Pas moyen de le quitter non plus puisque sans passeport. Alors je me suis armé de patience en me jurant que ça s’arrangerait et qu’une fois la liberté retrouvée, je marquerais le coup.Novembre et décembre, quand tout le monde préparait ses vacances, je ne pouvais toujours pas être sûr de quitter le pays. Cela a duré jusqu’au 20 décembre. Mon passeport récupéré, la cavalcade a commencé pour obtenir le billet d’avion, obtenir un autre papier (genre carte d’identité) pour pouvoir en sortir un autre qui prouve qu’on a payé ses impôts… et ça coûte 500 Bolivares.Et enfin, l’unique vol Air France de la semaine pour la Martinique affichait complet le jeudi 3 janvier.Une collègue de travail, responsable de la boutique du Gazebo et qui travaillait avant chez Air France, m’a proposé de descendre à l’aéroport de La Guardia avec elle et son mari qui partait à Paris par le même vol.Grâce à la dévotion de cette personne, l’angoisse de ne pas partir s’est volatilisée quand, après une heure de parlementations à l’enregistrement, on m’a remis une carte d’embarquement rouge et or « première classe ».Après de chaleureux remerciements à ces braves gens, je monte dans un Boeing 747 aux couleurs françaises réconfortantes. On m’installe vers l’avant de l’appareil dans un fauteuil hyper large et confortable, et pour fêter les retrouvailles avec la chance : champagne gratuit et à gogo, puisqu’en première classe !Ainsi le jeudi 3 janvier à 23 h 30, au décollage avec les petites bulles, une musique douce et la perspective d’aller vers ce vieux rêve des Antilles me transportent de joie et de bien-être.Encore une coupe de Champagne et l’on sert à dîner : caviar, assiette anglaise, couverts en argent, serviette en tissu, une carte des vins sympa, mais je reste au champagne.Je finis juste avec un petit pruneau à l’armagnac avant l’atterrissage.Vendredi 4 janvier (nuit)Minuit et demi : le jumbo vient de se poser sur le sol de Fort-de-France et s’immobilise devant l’aérogare ; on descend sur le tarmac, comme à Nice, pour marcher vers la douane.Déjà, le premier flic que je croise a une tête plus rassurante que les gardes nationaux vénézuéliens et me fait renouer avec la tradition de notre cher pays.Il fait chaud ici, vite, un taxi, qui m’emmène au cœur de la ville, face à la Savane, grand parc près du port où il y a beaucoup d’hôtels, complets pour la plupart, mais j’en trouve un bien cra-cra, qu’importe, il suffira pour cette première nuit.Je pose mon sac, prends une douche, quitte les boots et la veste blanche pour une liquette ample et des lattes et vais m’enfiler deux bibines au bar d’à côté.Il est déjà 1 h 30, le bar ferme ; les premiers Antillais que je rencontre sont très corrects et pas agressifs comme j’ai pu l’entendre dire à Caracas de la part de gens de la métropole venus s’y installer.Alors, bien en confiance et secoué par tant d’émoi, la curiosité et la pêche l’emportent sur la fatigue.Je marche vers la Savane, traverse les pelouses interdites (puisqu’ici on ne craint pas la prison pour ça) et je vais rendre visite à une vieille amie : la mer.Ce petit clapotis des vagues qui m’avait tellement manqué me souhaite la bienvenue.Je longe toujours le trait de côte en regardant la mer avec attendrissement, puis la baie des Flamands et les voiliers qu’elle berce au mouillage. Ça dure un bout de temps, cette méditation délicieuse, et je me tourne enfin vers la ville.Des maisons de deux ou trois étages, simplettes et tranquilles, qui rappellent un peu les bords de mer de Cancale à Granville. Dans les rues, pas grande animation, tout est fermé, mais je découvre, ébahi, des ruelles aux constructions de style colonial élancé et évocateur de voyage.Des enseignes où se mélangent le français et le créole me distraient jusqu’à la porte de l’hôtel où je vais me pieuter. J’ai envie de dire : « mais on est chez soi ici » !Autre anecdote, la rue de l’hôtel s’appelle rue de la Liberté… Tout un programme.Vendredi 4 janvier (jour)Le jour se lève avant moi et déjà, vers 9 h 30, les klaxons me réveillent.En bas, dans la rue, une animation ensoleillée et sympathique m’invite à descendre accomplir les premières phases de mon programme.Un brin de toilette avec la mer dans la glace et le bruit des drisses qui claquent le long des mâts, je remets aux calendes la grasse matinée.La poste est à deux pas, j’y retrouve avec plaisir le premier paquet de ta part contenant le walkman. Sans plus tarder je vais à la préfecture, à encore deux autres pas d’ici, pour accomplir une formalité sur les conseils de Gilbert, mon ami peintre corse rencontré à Caracas.Il est toujours préférable d’avoir deux passeports, et d’ailleurs le mien sera périmé en septembre 85 ; de plus, il comporte le visa vénézuélien peu souhaitable pour entrer aux USA (paraît-il).Je me rends au guichet des passeports, un vieux Martiniquais très brave me reçoit et je lui monte un bateau du style :— Je viens de l’étranger, j’ai perdu mon passeport, comment faire pour me déplacer sans avoir à retourner en France ?— Il faut télexer à la préfecture des Alpes-Mawitimes et si on a l’accord pour en faiwe un autre, pas de pwoblème, revenez dans une semaine.Sur ce, je cours faire des photos d’identité, les lui apporte et entame le dossier.Midi : je trouve un autre hôtel à 190 francs la nuitée. À un pas du premier, avec vue sur la cour, mais plus confortable, je m’y installe.Après-midi : tu verras sur le plan ci-joint que le centre d’intérêt de Fort-de-France est de même importance que Saint-Malo intra-muros et tu devines le plaisir de marcher dans ces rues où des commerces en tout genre se succèdent.Pas de perte de temps, pas besoin de voiture, une ambiance estivale et nonchalante. C’est un vrai retour à la dimension humaine, c’est intimiste. J’aime.15 h : je vois de beaux bateaux au mouillage, mais pense qu’il y a sûrement une marina où l’on peut les aborder de plus près et commencer à chercher un embarquement.Je me dirige vers le port et passe devant des murailles qui me rappellent à la fois Saint-Malo et Antibes. Décidément, ce vieux Vauban avait les mêmes goûts que moi pour les baies.Enfin le port lui-même. Beaucoup de gros bateaux de commerce, des quais, des entrepôts, mais pas de réel intérêt pour la plaisance ; le centre d’attraction est à l’autre bout de la baie, à côté du club de voile me dit-on. Il y a un petit bar et un appontement pour les dinghies – ou annexes – des voiliers au mouillage et c’est là qu’on peut trouver quelque chose.20 h : je me rends dans le bar en question connu dans le milieu marin sous son ancien nom « L’abri côtier » devenu bar des Flamands. Il y a à l’entrée un grand panneau pour afficher les offres et les demandes d’embarquement. En plus de ça, les gens sont d’un contact facile et la bière pas trop chère.Heureusement que je maîtrise l’anglais, ça me permet de bavarder avec des Allemands, Hollandais, Américains… L’ambiance me plaît, et une annonce pour les Grenadines attire mon attention. Le bateau en question doit arriver dimanche soir ou lundi matin. On verra. Comme j’ai pris rendez-vous pour lundi matin avec le consul des États-Unis, il n’y a pas le feu.Samedi 5 janvierAu matin : les taxis sont hors de prix et je hais les autocars, alors j’ai décidé de louer quelque chose dans la mesure du budget que je me suis fixé.La solution : louer une vespa 125 cm3, vu la température et le climat, c’est le pied ! 70 francs par jour, kilométrage illimité.Balade sur les petites routes qui sortent de Fort-de-France, je découvre des chemins ravissants avec des vallons et des jardins qui rappellent la Normandie. La végétation est riche, verdoyante, luxuriante.Au fil des kilomètres, j’arrive dans un patelin, lieu-dit « Le Carbet », où habite Paul Lofredi, frère de Gilbert, et cherche sa maison. Je la trouve, le fameux Paul a entendu parler de moi, il m’invite à déjeuner pour le lendemain midi.Soir : retour tranquille sur Fort-de-France et apéro dans le bar des Flamands. Rencontre avec un Américain complètement bourré qu’il me faudra ramener sur son bateau grâce à l’amabilité d’un autre skipper et son annexe.Dimanche 6 janvierLe téléphone de Lulu que j’attendais pour me décider entre la location ou l’embarquement arrive vers 7 h du matin ; ça m’a fait plaisir de l’entendre.Midi : chez les Lofredi, accueil très agréable et familial avec la rencontre d’un autre frère, Antoine. Journée très réussie.Soir : au bar des Flamands, en demandant au hasard le bateau des Grenadines, je fais connaissance avec Paul Visser, le Hollandais. Il parle très bien anglais, paraît simple et sain, me raconte son périple.Il a construit son bateau à Amsterdam, où il travaillait dans les chantiers navals, avec l’aide de sa fiancée ; le bateau terminé ils ont mis les voiles et décidé de prendre des vacances dans les Antilles françaises et hollandaises à bord de« Potvis », nom du bateau qui veut dire cachalot en hollandais.D’Amsterdam, ils sont descendus vers le nord de l’Espagne pour choper les Alizés. Puis escale aux Canaries, au Cap-Vert, et hop ! vingt jours de traversée sur l’Atlantique jusqu’à Fort-de-France.Au bout de quelques jours, sa nana est repartie à Amsterdam pour son business de poterie, lui, il prévoit cinq mois de vacances dans les Antilles.Mais il a un peu le blues par rapport à sa nana, et plus une thune, donc, il tente de faire du charter. Son bateau de 11 m en acier est très rationnel, mais pas assez sophistiqué ou confortable pour pratiquer des prix standards.Il m’invite à boire un pot à bord. L’embarcation a tellement de charme que j’y vois là une ouverture. Et surtout, le courant passe bien entre nous. Il projette de monter à Pointe-à-Pitre pour y emmener deux Danois et après redescendre à Fort-de-France ; il me propose de venir avec, je lui ai dit « stand-by », je me prononcerai après avoir vu l’autre bateau.Lundi 7 janvierMatin : je rencontre le consul des États-Unis me recommandant de Gilbert et sollicite un visa permanent. Le type me donne les papiers à remplir, mais il faut un employeur potentiel là-bas. Comme ce n’est pas le cas, je laisse tomber.Midi : je rencontre Paul (skipper de Potvis) et cherche le bateau des Grenadines. Il est déjà complet. Alors je me décide à partir sur Potvis dont le départ est prévu pour mercredi, suspendu à la décision des Danois qui attendent eux-mêmes leurs papiers.Soir : bar des Flamands, rencontre avec un autre français de vingt et un ans, Dominique, qui vient de travailler à New York quelques mois et voudrait connaître les Antilles avant de retourner en métropole.Il parle bien anglais, aussi la communication entre nous trois est aisée. On se fixe rencard au lendemain.Je vais manger rue Victor Hugo dans un restaurant tenu par un vieux Corse, Mariani, que m’a recommandé Gilbert. Accueil très sympa et bonne bouffe.Mardi 8 janvierGrasse matinée. Poste restante : encore des paquets, merci !Soir : meeting avec Paul et Dominique. On bouffe ensemble. Comme les Danois traînent un peu trop, on les élimine du programme et décide de partir tous les trois. Euphorie…On retourne au bateau, on chante quelques chansons de Jacques Brel, car Paul l’adore, surtout le port d’Amsterdam, et Dominique connaît par cœur son répertoire. La cohésion du groupe se trouve renforcée par une culture musicale très proche.Minuit : Paul nous ramène à terre puisqu’on a encore chacun un hôtel…À demain !En marchant dans la ville, Dominique et moi décidons de boire un coup.1 h : on n’a plus sommeil et on se demande si les boîtes locales fréquentées par les Noirs sont interdites aux Blancs ? Selon les bobards imbéciles.On descend dans une discothèque, super musique, super danse, beaucoup de reggae et biguine et la cohabitation avec les Noirs ne fait aucun problème. Ça nous rassure et nous enchante.Mercredi 9 janvierUne vieille gueule de bois nous empêche de faire le matin des achats prévus pour la croisière.Après-midi : on remplit le bateau de victuailles et de boîtes de bière, glace vive, et Dominique, qui a quelques dollars à dépenser, achète une guitare.Soir : nos sacs sont à bord également, maintenant il faut prendre le rythme de la mer et du soleil sans plus se soucier de la vie terrestre. Plus facile dans ce sens-là que l’inverse.19 h : nous sommes invités à prendre un ti-punch à bord de « Favignana », superbe ketch (ça veut dire deux mâts) de 14 m construit à Antibes par son skipper Christian, très sympa, qui fait du charter l’été entre la Côte d’Azur et la Corse, et l’hiver aux Antilles.Bateau très classe ; puis on invite Christian à venir sur Potvis où l’on se fait un apéro-dînette agrémenté de guitare et chansons françaises, américaines aussi.Jeudi 10 janvierDerniers achats à terre, dont des cordes de guitare, les précédentes n’ayant pas résisté au délire de la veille au soir…16 h : on lève enfin l’ancre. On sort de la baie des Flamands, cap sur Dominica, au nord de la Martinique.Temps superbe, bon petit vent, ton fils à la barre, Paul aux écoutes, Dominique à la guitare. Potvis n’a pas la fougue des bateaux polyester que je louais à Nadia, mais il est conçu pour l’Atlantique, donc solidité et fiabilité sont ses qualités premières.À la tombée de la nuit (18 h) on aperçoit la Dominique, mais le vent tombe, un grain passe et l’équipage préfère mouiller en rade de Saint-Pierre pour repartir demain en forme de bonne heure.Vendredi 11 janvier10 h : ancre relevée, on met les voiles, cap sur Dominica. Temps radieux.Une radio périphérique de Fort-de-France nous balance des biguines et reggaes à craquer les haubans, des pubs qui avec l’accent créole prennent l’allure de gags.Un bulletin météo de France métropolitaine annonce -30 °C dans le Jura, -10 °C à Paris, -4 °C à Nice !J’ai une pensée émue pour mes concitoyens pendant que Potvis me transporte de bonheur ; je suis obligé de mettre une liquette pour avoir moins chaud !La nuit tombe à 18 h 15 sans variation tout au long de l’année.19 h : l’approche de « Roseau », la baie où l’on va mouiller en Dominique, se fait prudemment, car les feux de navigation sur les îles anglaises sont inexistants ou en panne et il y a des rochers. Alors, gaffe ! Je suis à la barre, Paul à la table à cartes et au sondeur, Dominique à la vigie.À la lueur des seuls deux hôtels de ce patelin, on prend notre mouillage près des cailloux. Bouffe à bord, guitare, jokes, plaisanteries, rires et dodo.Samedi 12 janvierLes collègues décident de passer la journée et la nuit ici pour visiter demain. Je ne suis pas de cet avis, désireux avant tout de naviguer plutôt que de traîner à terre. Je fais un peu la gueule, mais la suite sera si piquante que je n’aurai pas l’ombre d’un regret.Midi : on prend un taxi collectif pour aller visiter les « falls », chutes magnifiques sur une hauteur de l’île. Surprise : ils conduisent à gauche et je retrouve les Austin, les mailbox rouges, les panneaux, la signalétique de la vieille Angleterre.Normal, Dominica est indépendante depuis seulement six ans, mais la colonisation anglaise a laissé des traces.Les Noirs parlent un anglais très haché et traînant avec des expressions bien à eux, mais parlent aussi le créole. Moi qui ai travaillé avec des Haïtiens pendant neuf mois, j’ai des notions dans cette langue ravissante qui me permet d’approcher ces gentils rastas tout sourire au-dehors.Les chutes sont admirables et gigantesques, avec des jaillissements d’eau chaude et un petit bar ombragé où l’on rencontre des Américains émerveillés de notre croisière. Traverser l’Atlantique sur un bateau de 11 mètres, ça les dépasse…On retourne au bateau et après une bouffe (dont j’ai la charge permanente) un peu de guitare, une sieste, la soirée est déjà entamée et l’on veut voir ce que donne le Saturday Night ici.Descente à terre. On marche jusqu’au cœur du village. Pas grande animation, pas trop de lumière, les bicoques en bois gris qui jalonnent la route défoncée dégagent néanmoins une atmosphère « reggae » au sens large du terme.Trois Blancs comme nous, bronzés, en haillons, un peu pétés, le boyau de la rigolade en l’air, c’est le meilleur moyen d’approcher les rastas. Pas de crainte à avoir, au fil du chemin, un mot aimable à chacun, on n’a pas la dégaine « touristes », mais plutôt aventuriers.On branche deux nanas qui nous emmènent dans un bar où il n’y a pas assez d’ambiance, alors que l’on voudrait danser. À la lueur des lampes, les filles sont jeunettes et l’on ne veut pas d’histoires. Alors on leur paye à bouffer et on les largue gentiment.Sur le retour vers le bateau, on aperçoit une bicoque : quelques planches de bois, quelques tôles en guise de toit, du monde à l’intérieur, de la musique, de la fumée de barbecue et Ganja (Marijuana). Comme il y a un mec à l’entrée, on croit que c’est une boîte locale et on rentre.Aussitôt encerclés de rastas en liesse, on se met à danser, provoquant l’hilarité générale. Les filles nous invitent à danser et nous portent à boire un punch à faire bander les morts.En fait, on était chez des gens qui fêtaient l’anniversaire d’un des leurs. On a filé quelques dollars Biwi(*) pour participer aux frais en faisant attention de ne pas vexer non plus.(*) ou E.C.dollars : c’est le dollar en vigueur dans les îles anglaises des Caraïbes ; la reine Elizabeth II en photo sur ces billets me fait tellement penser à Mémé, son sosie…Puis on est allé chercher une bouteille de rhum sur le bateau. Ils ne voulaient plus qu’on parte. Quand les flonflons se sont calmés avec cinq Noirs, on a cherché un troquet en ville.Tout était lourdé, chemin faisant, ils nous ont expliqué l’histoire de leur indépendance, sans aucun propos de haine ou d’amertume envers les Anglais ou les Blancs en général. On a chanté sans orchestre les chansons de Bob Marley que l’on connaissait ensemble, dont la fameuse « Redemption Song ». Ils étaient ravis que l’on connaisse et respecte leur culture, et avant de se quitter ils nous ont invités à les retrouver pour le carnaval de février qui vaut le coup, c’est ce que tout le monde dit.Au moment des adieux, ils savaient tous nos prénoms.Paul y retournera en février et donnera des nouvelles de Dominique et moi.Je te jure qu’à l’issue d’une telle fête les préjugés racistes tombent bien bas.4 h du matin : retour sur Potvis, encore enchantés de ce que l’on vient de vivre.Dimanche 13 janvierCap sur « Les Saintes », minuscule archipel où l’on jette l’ancre à la nuit tombée. À côté, un bateau que connaît Paul ; le skipper est son voisin de port à Amsterdam. On prend un pot ensemble : guitare, ti’punch et joie de vivre.Lundi 14 janvierOn va mouiller (jeter l’ancre) dans la baie d’en face ; sur l’autre caillou se dresse sans prétention un village de rêve au point que l’on croirait tourner dans une opérette. Quelques pas dans les rues entre des maisons en bois super bien entretenues, mais sans frime non plus. Pas de piège à touristes, les seuls bateaux qui viennent se perdre ici respectent le lieu et sa tranquillité. Sauf nous qui avons fait une bringue pas possible le soir.On fait quelques courses : cigarettes, bière, glace (…) sous un soleil généreux ; la place du marché avec une bicoque Gendarmerie nationale et un petit Crédit Agricole nous rappelle que l’on est en France, département de Guadeloupe. Seules ces institutions nous rattachent à la civilisation.On y est tellement bien que l’on s’affale à la terrasse d’un petit resto créole : tabouret, toile cirée, menu créole dont boudin noir, acras de morue, purée d’iguane, poulpe, un rosé qui n’a jamais vu la Provence… des salamandres qui courent à nos pieds, j’en ai même plus peur. Un transistor donne des nouvelles du monde et de la France : ça m’amuse, car j’ai du mal à me situer par rapport à tout ça.15 h : retour au bateau. Je nettoie les herbes qui envahissent la ligne de flottaison avant de faire la sieste.18 h : apéro avec l’équipage de Rosa, l’autre bateau hollandais. La guitare met tout le monde sur le pont ; j’ai l’inspiration et tiens en haleine mon public jusqu’à 21 h. Petite bouffe.Le village nous a tellement plu qu’on y retourne pour voir l’ambiance de nuit. Et puis on n’a plus rien à boire à bord.Premier troquet : le bar d’un hôtel. La serveuse est tellement gentille qu’on voudrait l’embarquer, mais elle est mariée, blanche, et parle créole comme beaucoup de gens de cette île.Deuxième troquet : la crêperie tenue par un couple de jeunes « métros » très sympas. Terrasse plein air un peu en hauteur ; on nous sert à boire dans des hamacs. En bas, dans la baie, Potvis se balance au bout de son ancre. Il n’y a que lui de sérieux dans cette histoire.Après une demi-heure arrivent deux autres clients. On a la pêche, les tauliers mettent des cassettes de reggae et c’est reparti pour un tour. Jam jusqu’à 3 h du matin. On refait le monde avec ces nouvelles rencontres, et encore des adieux, puis dodo.Mardi 15 janvierCap sur la Guadeloupe. Je barre toute la journée et me fais l’entrée du port de Pointe-à-Pitre à la tombée de la nuit suivant les balises qui signalent les cailloux. Le port est sale et pas très hospitalier. On mouille près des barcasses de pêcheurs.Descente à terre. La ville est moins sympa que Fort-de-France. On trouve un bon bar, correct, et on nous indique un petit resto.Dans une rue sombre, une des enseignes « Chez belle-mère » attire notre attention. On rentre, c’est une pension de famille. C’est tellement désuet et vétuste qu’on tente le coup, toujours en quête d’insolite et d’inattendu, je suppose.La vieille doudou nous apporte à dîner : soupe, ragoût de bœuf, vieille piquette des vignes guadeloupéennes, la télé avec Coco boy et Bouvard. On est reçu un peu comme à Arbois.Avant de partir, il faut aller faire la bise à la belle-mère, c’est plus important que l’addition.En retournant au bateau, on achète une bouteille de rhum dans une épicerie des bas quartiers. On nous offre à boire autour d’une table en compagnie des locaux.Paul qui voudrait apprendre le français se démerde déjà bien en créole ; gag !Le retour à bord est mouvementé. Et la guitare en voit de toutes les couleurs.Mercredi 16 janvierRéveil tardif, gueule de bois générale ! Rangement et nettoyage à bord puisque l’on prévoit 24 heures de navigation pour rejoindre Fort-de-France directement.Après-midi : quelques formalités de douane, quelques courses.Enfin vers 18 h, on relève l’ancre. Cap sur Fort-de-France, Dominique à la barre, Paul au plumard, je m’assoupis également.20 h 30 : je fais la bouffe et dors jusqu’à 1 h 30, donc on est jeudi 17 maintenant. Paul me réveille pour prendre la barre, on est au large de Marie-Galante en vue de Dominica côté est, c’est-à-dire sur l’Atlantique.Pas beaucoup de vent, la consigne : tenir bon le cap, surveiller les feux de navigation et si possible donner de la vitesse au bateau. Un peu embrouillé, la bouteille de flotte à côté, je caresse cette roue en bois style vieux gouvernail, tu connais ? Et les yeux rivés sur le compas lumière rouge comme dans les cockpits d’avion.J’attends que tout le monde soit couché pour régler les voiles à ma façon et entamer un vieux dialogue entre la mer, les étoiles, le bateau, et moi. On est sur l’Atlantique, les vagues sont longues et fortes, mais elles vont dans le même sens que moi. Une petite prière pour avoir du vent, le Bon Dieu reçoit cinq sur cinq et m’envoie une brise idéale.2 h : la brise force légèrement, pas de problème pour Potvis qui a l’habitude. Les voiles bien réglées, le cap bien choisi, un clair de lune qui facilite l’observation et Potvis file tranquille 6 à 7 nœuds. Il n’y a plus qu’à barrer et rêver… sans dormir.C’est la fête, les dauphins arrivent en pagaille et chahutent avec la coque. Leur petit cri de bienvenue ne me trompe pas. Ce ne peut être des requins. De toute façon, c’est pas l’heure du bain.3 h : la nav va… et je pense qu’en remontant ces courants et alizés il y a un pays et tant d’amour, je jette un œil sur ma montre : on est le 17, c’est l’anniversaire du petit Julien de Champigny. Je me promets de planter ces souvenirs dans ma tête pour lui en faire un jour apprécier la saveur.4 h : mêmes conditions, je quitte quelques secondes la barre pour aller voir à l’avant si le bateau donne le maximum de sa pêche. Ça va, il donne bien. Les milles nautiques défilent, je repense à la bonne école Diapason qui m’avait donné les premières satisfactions de la navigation de nuit et la formation aussi.Et puis, évidemment, je pense à toi qui découvriras peut-être tout ça un jour, je ferais tout pour.5 h : parfois, Dominique ou Paul me le demandent l’heure. Je triche un peu pour garder la barre et répond : « It’s only 3 : 30 » (il n’est que 3 h 30)…5 h 30 : le jour va se lever sur l’horizon et je ne veux pas rater ça.6 h : c’est vrai que j’ai bien barré, on arrive au sud de Dominica et on devine la Martinique au loin. La lueur du soleil estompe les étoiles qui m’ont accompagné dans cette rêverie, sans fumée, sans alcool, juste du sel et du vent.7 h : les deux autres complices se lèvent pour prendre leur quart.Captain Paul me félicite pour la bonne marche ; je vais me coucher vidé, épuisé, mais si heureux…14 h : réveil au large de Saint-Pierre en Martinique, je prépare un copieux déjeuner. Après quoi les deux font une sieste. Je reprends la barre et me fais l’arrivée à Fort-de-France.18 h : le copain d’Antibes sur Favigna nous voit arriver et comme il s’emmerde un peu en attendant ses clients, il nous bigophone en VHF.Apéro ensemble. On raconte nos tribulations terrestres. Il est ébloui. Bouffe, guitare, minuit arrive et mes deux collègues bien partis veulent faire un tour à terre dans la boîte des Noirs que je connais.Je préférerais aller me coucher, mais, finalement, étant le plus clair des trois, je les accompagne pour qu’ils ne fassent pas de conneries.Tout se passe bien, on danse jusqu’à 3 h du matin.Vendredi 18 janvier10 h : je file à la poste. Il y a encore des paquets-lettres de Mâ et… Une lettre de mon père…10 h 30 : préfecture de Fort-de-France. Je demande au pépé antillais – qui me reconnaît aussitôt et m’appelle par mon nom – ce qu’il advient de mon passeport, il me répond :— Ah bah ! Si on avait le timbwe fiscal il serait déjà fait puisqu’on a le feu vert des Alpes-Mawitimes.— Et avec le timbre, combien de temps ?— Pour lundi.— Ça fait tard, car je dois partir en bateau à Sainte-Lucie et je risque d’en avoir besoin.— Oh ! Alors je ne veux pas que vous ayez des pwoblèmes avec les autorités anglaises… Allez acheter le timbwe à 335 francs et je fais le possible pour vous le sortir à 11 h 30.Et à l’heure dite, le pépé me refile un beau passeport tout neuf valable jusqu’en 1990 avec pour seule adresse « Fort-de-France, Martinique ».Chapeau ! non ?12 h 35 : en retournant au bateau je passe devant l’ambassade des États-Unis. Je monte en short, pas rasé et demande un visa touristique pour aller en bateau à Puerto Rico ; ça paraît plausible. Les bureaux ferment à midi et je remplis la fiche en vitesse. Le consul me dit :— Alors vous avez changé d’avis ?— Oui, j’ai trouvé un bateau pour passer aux îles Vierges et il me faut un visa au moins touristique.— Okay, repassez lundi matin, ce sera fait.— Mais, Monsieur le Consul, le bateau part demain…— Well ! Revenez cet après-midi vers 15 h, ce sera fait.Ainsi je me retrouve avec mon arme secrète : un deuxième passeport qui comporte un visa d’un an pour les States. Ça ne permet pas d’y travailler légalement, mais au moins d’y circuler. Chapeau ! Non ?Soir : partie de dominos à bord de Flavigny.Samedi 19 janvierMeeting de l’équipage. Dominique n’a plus beaucoup de sous et décide de rentrer en France. Paul et moi décidons de faire route vers le sud.Midi : quelques courses pour avitailler le bateau, achats, puis dernier déjeuner avec Dominique qui s’en va. C’est triste de voir partir un tel coéquipier même s’il ne comprenait rien à la voile. Les seules « cordes » qu’il maîtrisait à merveille étaient celles de sa guitare.Un taxi l’embarque pour l’aéroport, on n’a pas de foulards ni de madras à agiter, mais c’est le cœur serré qu’on voit la Peugeot s’éloigner.15 h : on appareille, ne reste plus que Paul et moi à bord.17 h : on jette l’ancre dans une baie au sud de Fort-de-France, l’anse d’Alett. Ça a l’air sauvage et mignon à la fois. L’eau y est si pure que l’on se baigne volontiers.18 h 30 : on va prendre l’apéro à terre. On tombe dans un troquet où les pêcheurs viennent à notre table, la bouteille à la main. On se met à parler créole, les vapeurs d’alcool aidant. Paul est en forme. Je le ramène à bord pour dîner, car il a un peu perdu la maîtrise de la déambulation.21 h : on retourne à la bicoque des pêcheurs qui nous en veulent presque de ne pas avoir dîné avec eux. Le lendemain, il y a une régate de barques à voiles et ils voudraient qu’on y participe. On dit OK !Minuit : dodoDimanche 20 janvierCap sur Santa Lucia. Le vent est super et tant pis pour les pêcheurs oubliés, on veut profiter des bonnes conditions de navigation.17 h : bureau des douanes à Castrix, car on fait tout en règle. Engueulade avec les douaniers qui sont des petits cons.18 h 30 : mouillage en baie de Marigot au sud de Castrix. Paysage typiquement carte postale. Baie refermée par bancs de sable et cocotiers, trop frime vu les bateaux de milliardaires qui y mouillent.Puisqu’on y est : descente à terre, petit bar snobinard, personnel noir parlant anglais. On essaye un autre bar à deux brasses de dinghy de là. Plus sympa. Rencontre avec un Texan et un Canadien qui ont la cinquantaine et un accent gratiné. Après quelques jokes et quelques punchs cocos, on retourne sur Potvis.Déjà bien pétés, et pour faire chier nos snobs voisins de mouillage, on se retourne avec l’annexe avant d’arriver au bateau. Peu importe, on sait encore nager.On rétablit la situation et l’on commence à mettre de l’ambiance dans la baie, car Dominique nous a laissé la guitare. On bouffe. Le lendemain, tout le monde saura que l’on s’est retourné avec le dinghy.21 h 30 : pendant que je discutais avec le Texan, Paul a su par un rasta qu’il y avait une boîte pour danser à 2 km du premier bar en montant sur la colline.22 h : on retourne à terre. Bar. Pot avec le Texan.23 h : on va vers ladite boîte de rastas. Je marche pieds nus sur les cailloux de cette route ; tellement pris par l’ambiance que j’en ai oublié mes lattes en bas.On arrive dans une bicoque d’à peu près 30 m² bourrée de monde (noire de monde) où l’on est les seuls Blancs. Super accueil.On danse le reggae jusqu’à épuisement. J’ai branché une petite Noire et pensais bien la ramener en souvenir, mais la maman et le grand frère étaient là, pas du même avis. Alors « cool man, pas ni pwoblem ! » J’ai laissé tomber. Retour au bateau, à moitié morts… de fatigue.Lundi 21 janvierLe captain est mal-en-point et préfère se reposer plutôt que de prendre la mer.Mardi 22 janvierCap sur Fort-de-France. Un bon vent frais me permet de m’éclater à la barre.Arrivée de nuit sous voile dans la baie de Fort-de-France, accompagnée d’une bonne musique sur la radio locale qui diffuse un programme spécial Elvis Presley.Depuis deux heures, on régatait avec un voilier qui venait aussi de Dominica. J’ai gagné !Comme il est temps pour moi de penser au retour à Caracas, ces deux heures de navigation nocturne ont terminé la croisière à bord de Potvis en apothéose.Mercredi 23 janvierJe devrai être ce soir à l’aéroport vers minuit puisque le vol est à 4 h du matin jeudi et que je suis encore en liste d’attente. La perspective de retrouver Caracas ne m’enchante guère, mais j’ai besoin de fric et c’est là-bas qu’il se trouve.9 h : avant de quitter la perle des Antilles, je téléphone tous azimuts aux hôtels quatre étoiles pour voir les possibilités de travail ici. Hélas, rien ne prend, les quatre étoiles sont pourvus en personnel. La haute saison est en cours et les brigades sont formées.Je vais quand même au Méridien qui me donne l’adresse du responsable à Paris pour l’embauche du personnel dans le monde. Quant aux petits restos et pâtisseries de l’île, le salaire maxi plane entre 5 et 6000 francs.20 h : dîner d’adieu avec Paul au resto de Mariani, brave Corse dont les conseils peuvent me servir pour plus tard.Paul me dit qu’il rentrera vers avril ou mai en Europe avec un copain hollandais et éventuellement moi, si je peux me libérer. Ça me plairait de faire la transat, même hors course.Jeudi 24 janvier4 h 30 : j’embarque pour Caracas. Adieu foulards, adieu madras. J’ai laissé mon cœur sur Potvis et entre les cailloux, les ruelles de ces îles qui me tiendront chaud jusqu’à ce que je les retrouve.Dans l’avion, je me dis : « tiens encore quelques dollars en poche, je pourrais presque aller jusqu’à Puerto Ayacucho, mais je suis fatigué et ça m’emmerde d’arriver les mains vides chez les copains d’Amazonie. »5 h 30 : arrivée à Caracas. Robert Provost (mon patron) est là pour accueillir des gens de sa famille qui ont pris le même avion que moi. Je remonte au Gazebo avec eux. J’économise le taxi, mais ça me fait flipper quand même.6 h 30 : je discute avec le secrétaire du restaurant, señor Jo, ce vieux Français qui s’occupe de la paperasse, de l’administratif, il m’a à la bonne. Il me demande ce qui a été convenu entre Robert et moi pour les papiers, déclaration, contrat, etc.Je lui confie que je n’ai pas l’intention de finir l’année ici, et même que « le plus vite je pourrai repartir, le mieux ce sera ». Il me propose d’en parler à Robert. Je lui demande d’attendre, je préfère affronter la bête directement.7 h : je vais me coucher.16 h : un collègue de travail, le charcutier, passe, on va boire un pot en ville. Je lui raconte mes vacances et il me dit que personne n’a fait aussi bien que moi. On retourne au Gazebo (où j’ai ma piaule).Je retrouve la Mustang qui ne démarre pas, et pour cause. Je lève le capot : on m’a piqué l’alternateur et la batterie… Bienvenue de retour à Caracas !17 h : je rencontre Robert en pensant demander d’autres horaires, une indemnité logement, bref, des trucs qui me permettraient de vivre mieux ici ; mais j’ai le sentiment que cette ville n’est pas faite pour moi et je lui balance le morceau.Pas d’éclat de voix, pas de tiraillements. On fixe mon préavis entre deux et quatre mois. De toute façon, le temps de trouver un remplaçant.18 h : je te téléphone et tu sais tout.Dimanche 27 janvierRecord battu ! 27 pages de bla-bla (ndlr : manuscrites) ; c’est bien parce que c’est toi.Faut dire que ça m’a fait plaisir de retracer les plus belles pages de ma vie dans cet enchaînement de faits divers et d’été.Demain, je vais reprendre le boulot avec autant d’intérêt que mes jours sont comptés ici ; j’ai l’impression de retrouver à Caracas des gens qui m’envient ou s’interrogent sur ma belle indépendance.Pour satisfaire ta curiosité, je vais expédier ces notes, ou carnet de bord, des Antilles, sans plus tarder. Le cadeau du 21 février arrivera plus tard, s’il arrive…Mais cette lettre, je le sais, te fera plus plaisir que toute autre intention pour ton anniversaire proche.Je t’embrasse très fort !Ton fils