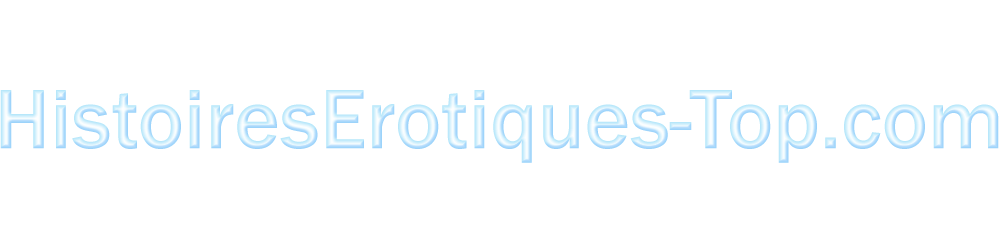Le premier mai, je fais ce qu’il me plaît. « Papa, je quitte la maison et je pars vivre aux Antilles avec Audrey ».Je ne vais pas prétendre que la révélation que me fit Charles, il y a dix jours, constituât une réelle surprise pour moi, mais je pressentis néanmoins que j’allais avoir quelque mal à l’encaisser.Il est vrai que ce n’est pas la seule contrariété à laquelle je suis actuellement confronté. Ma situation financière est particulièrement inconfortable et mes affaires bien mal engagées.Je crains d’ailleurs d’être l’ultime représentant d’une dynastie née avec la révolution industrielle, et de m’inscrire dans l’histoire familiale comme celui qui aura contribué à la fin d’une épopée dont la réussite semblait jusqu’à peu indéfectible.La famille Dubout-Courtepine est associée à l’industrie de cette vallée depuis si longtemps que la disparition de l’entreprise éponyme provoquerait inévitablement un traumatisme dans le Landerneau local.L’origine de cette épopée industrielle remonte à l’époque à laquelle Henri Dubout, alors fraîchement marié à Hortense née Courtepine, créa son premier atelier de verrerie, sur le site même où je me bats aujourd’hui afin de faire survivre mon usine de boules à neige.Jusqu’à la fin du dernier millénaire, les héritiers successifs d’Henri avaient réussi, malgré les aléas de l’histoire, à développer l’entreprise familiale et lorsque mon père en prit les rênes, elle était toujours rentable, sinon prospère. Mais confronté à la volonté plus ou moins déclarée des gouvernements post Trente Glorieuses d’abandonner l’industrie désormais obscène au profit d’une société de services et de loisirs idéale, Jacques-Henri Dubout-Courtepine, mon père, décida, à l’aube de la soixantaine, de solder l’essentiel de son patrimoine professionnel et de donner la plus grande partie du fruit de la vente à ses enfants, avant d’aller vivre à l’année avec son épouse dans la maison familiale située sur la côte basque.De par ma formation et mon appétence pour les machines-outils plus ou moins sophistiquées, je fus naturellement celui à qui mon géniteur transmit la dernière usine qu’il n’avait pas souhaité céder à un repreneur qui, une fois les subventions encaissées, n’aurait eu de cesse de la liquider. J’y avais effectué toute ma carrière professionnelle après l’obtention de mon diplôme de l’école centrale et j’en étais naturellement devenu le directeur dans ma trente-troisième année.Lors de cette donation plus que conséquente, mon frère aîné, chirurgien réputé installé à Neuilly sur Seine, s’était contenté de récupérer son lot de millions pour financer l’extension de sa clinique privée alors que ma sœur avait profité de l’aubaine pour racheter les parts de ses associés dans une des études notariales les plus prospères de la capitale.#####Immanquablement, la phrase prononcée par mon fils me plongea dans un abîme de réflexion et j’ai aussitôt repensé au discours que me tint mon frère Thibault, lorsque je fis part à la famille de mon souhait d’épouser en seconde noces Audrey Duluc-Anffeut, fille cadette d’un riche négociant, dont la famille avait émigré aux Antilles au début du siècle dernier pour y faire fortune. « Tu n’as visiblement pas retenu la leçon de ton premier mariage » m’avait en substance déclaré Thibault, avant d’ajouter fataliste : « Tu te laisses une nouvelle fois submerger par tes instincts primaires en choisissant une compagne bien trop jeune et désirable, dotée de surcroît d’un tempérament largement incompatible avec la fougue ordinaire d’un Dubout-Courtepine » .Il n’échappera pas à l’observateur attentif que mon épouse actuelle, de quinze ans ma cadette, a du sang noir dans les veines. Et il n’est pas absurde de penser que ce patrimoine génétique puisse être en partie à l’origine de son corps de liane aux rondeurs fermes et nerveuses et de son appétence certaine pour les ébats amoureux qui me comblèrent et m’épuisèrent lors des premiers mois de notre union.En me mariant avec Audrey, je ne fis en effet que reproduire le schéma qui m’avait conduit, dans ma vingt-cinquième année, à épouser Agnès ce qui, aux yeux de Thibaut, constitua la première faute impardonnable de ma vie affective. J’avais en effet, à cette occasion, passé outre la tradition consistant, chez les Dubout-Courtepine, à convoler avec des femmes menues à l’air réservé et aux atours ordinaires, pour lesquelles la seule utilité d’une sexualité assumée se résume à la perpétuation de la lignée.Plutôt grande, dotée d’une longue chevelure noire et de formes généreuses trahissant des origines partiellement méditerranéennes, Agnès était dotée d’un physique et d’un tempérament bien éloignés des standards de l’épouse Dubout-Courtepine ordinaire. Et sa sensualité à fleur de peau m’avait tourneboulé les sens dès notre première rencontre. J’étais alors étudiant en dernière année à l’école centrale de Paris et le caractère aussi imprévisible qu’exubérant d’Agnès tranchait singulièrement avec l’aspect terne et la réserve de ma précédente petite amie.Exactement neuf mois moins une semaine après notre nuit de noces naissait Charles, solide bébé de quatre kilos, dont la carrure et les attributs virils dénotaient quelque peu par rapport aux traits physiques des mâles Dubout-Courtepine, d’une taille certes située dans la moyenne supérieure, mais, qui sans être chétifs, possèdent d’ordinaire une corpulence plutôt mince et un membre viril aux proportions assez modestes.Pour respecter une tradition quelque peu désuète, imposée par ma mère, Agnès et moi avions passé la quinzaine précédant le mariage dans nos familles respectives ce qui eut pour conséquence que notre nuit de noces fut particulièrement animée.Dès l’adolescence, Charles s’avéra très porté sur la chose et si sa mère trouvait ça plutôt amusant, je m’en inquiétais quelque peu.À cette époque, l’affaire dont j’étais devenu depuis peu le président et principal actionnaire n’était déjà plus très florissante et les juteux bénéfices du passé servaient souvent à renflouer la trésorerie défaillante de l’entreprise.Il me fallait donc trouver de nouveaux marchés pour écouler les produits confectionnés par la dernière fabrique de boules à neige de la région.C’est lors d’un séjour à Paris, après quelques promenades dans les quartiers touristiques de la capitale, que me vint l’idée saugrenue de contacter des sociétés africaines d’import-export pour leur vendre une partie de ma production. J’avais en effet constaté que la majorité des revendeurs à la sauvette qui proposent ces jolis objets de décoration mettant en valeur des miniatures du Sacré-Cœur ou de l’Arc de Triomphe dans un joli écrin de plastique rempli de liquide trouble, étaient d’origine subsaharienne.Ma prospection ne fut pas totalement vaine, car je finis par rencontrer un riche homme d’affaires ivoirien qui sembla fort intéressé par les produits de ma société après que je lui ai vanté les avantages du made in France sur la piètre qualité de la concurrence asiatique.L’affaire semblait si bien engagée que je décidai d’inviter ce personnage haut en couleurs, prénommé Félicien, à passer un week-end dans le manoir familial. J’espérais que cette marque de considération constituerait l’élément déclencheur d’une juteuse commande pour mon entreprise.Et effectivement, Félicien apprécia son séjour au-delà de mes attentes, n’hésitant pas à profiter de manière fort peu conventionnelle de l’accueil extrêmement chaleureux de la maîtresse de maison. À tel point que deux mois plus tard, Agnès me quittait pour suivre Félicien et partager sa vie entre Paris et Abidjan en emmenant dans ses bagages, Bénédicte, notre fille cadette.Comble d’infortune, mon usine ne vit évidemment jamais arriver la moindre commande de la société du nouveau compagnon d’Agnès.La mère de Charles partie, une fois le délai imposé par la bienséance écoulé, j’eus diverses occasions de croiser quelques vieilles filles et d’autres, certes plus jeunes mais tout autant dénuées de charme, que les notables de la région s’évertuaient à me présenter. Mais aucune de ces tentatives destinées à me recaser ne fut couronnée de succès.Jusqu’au jour où je rencontrai Audrey, que je finis par épouser, au grand dam de mon frère, peu de temps après que Charles eut fêté ses dix-sept ans.###Depuis que les événements récents ont, par la force des choses, fait de moi un néo-célibataire, je n’ai guère le cœur à regagner chaque soir ma grande demeure, que j’ai en outre dû largement hypothéquer pour combler une partie des dettes de l’entreprise. N’ayant rien de mieux à faire ailleurs, je traîne au bureau pour traiter les affaires courantes et préparer une liquidation judiciaire qui semble de plus en plus inéluctable. Une partie non négligeable de mes journées se passe en négociations avec mes créanciers et les représentants d’un repreneur éventuel qui aimerait récupérer le domaine et ses bâtiments en brique pour en faire un luxueux complexe hôtelier avec spa, piscine et salles de séminaires.Évidemment la situation précaire de la société n’a pas échappé aux employés qui s’attendent à l’annonce prochaine d’un plan social et j’ai, bien sûr, de nombreux échanges sur ce sujet avec Marianne, la déléguée du personnel, une femme de trente-cinq ans à la chevelure de feu, qui, avec ses tâches de rousseur, son petit nez légèrement épaté et ses dents du bonheur, a des faux airs de Marlène Jobert.Mon temps libre et l’activité réduite de l’entreprise ont permis à nos entrevues, jusque-là très formelles, d’évoluer vers des considérations plus personnelles et j’ai pu par ce biais obtenir pas mal d’informations concernant ma déléguée du personnel.Mère d’un garçon de seize ans qui habite majoritairement chez son père, Marianne n’a, depuis son divorce, pas eu l’occasion de rencontrer un homme digne à ses yeux de partager sa nouvelle vie. Il est vrai que pour oublier les péripéties d’une séparation relativement douloureuse, elle fit alors le choix de privilégier son engagement syndical à la recherche d’un successeur à son ex-mari.####Depuis le départ d’Audrey et Charles, les discussions que j’ai avec Marianne ont tendance à se prolonger au-delà de l’horaire contractuel et, ce jeudi 30 avril en fin d’après midi, alors qu’un long week-end s’annonce, j’appréhende le départ imminent de ma déléguée du personnel.— Je ne pourrai pas rester très tard cette après midi, m’a-t-elle déclaré avant que nous entamions notre négociation quotidienne. Car demain, je pars à l’aube avec des camarades venus de toute la vallée dans le car affrété par le syndicat pour nous permettre de participer au grand défilé annuel du premier mai à Paris.Devant mon air désappointé, Marianne se fend d’une petite phrase sibylline que j’imagine destinée à m’apporter un peu de réconfort.— J’espère que vous profiterez vous aussi de ce long week-end pour vous détendre. D’après la météo, nous aurons droit à un temps estival, me déclare-t-elle avec un gentil sourire.J’ai pu en effet à l’occasion évoquer devant elle, sans bien sûr entrer dans les détails, ma situation personnelle et malgré nos intérêts divergents, elle semble y attacher quelque importance.— Je ne sais pas trop, je vais bien sûr essayer de me reposer un peu. Je vous avoue que j’ai un peu de mal à dormir ces derniers temps.Marianne répond par un faible sourire au regard abattu que je lui adresse alors qu’elle s’apprête à quitter mon bureau.####Je viens enfin de trouver le sommeil lorsque mon téléphone se met à sonner. En découvrant l’heure fort matinale et le nom de la déléguée du personnel de mon entreprise sur l’écran de mon smartphone, je me sens gagné par une certaine inquiétude.Craignant un coup d’éclat des employés à la veille de la fête des travailleurs, je prends l’appel le cœur battant.— Je vous dérange ? demande Marianne d’une voix enjouée.— Je ne sais pas si c’est le mot adapté. Ce qui est sûr, c’est que vous venez de me tirer d’un sommeil que j’ai eu bien du mal à trouver.— Dans ce cas, c’est parfait. Je vous donne vingt minutes pour vous préparer avant que je vienne vous récupérer chez vous et vous emmener profiter d’une jolie balade à Paris.— Mais qu’est-ce que vous racontez ? Vous êtes tombée sur la tête ? Allô Marianne ? Vous m’entendez ?Elle ne me répond pas, car elle a déjà mis fin à la conversation. Je me remets doucement de cet échange surréaliste et je finis par me dire que plutôt que me morfondre tout le week-end, je peux très bien saisir la perche tendue.Je fonce sous la douche, me brosse les dents et jette quelques vêtements dans un sac de voyage avant de quitter la vaste maison pour me rendre jusqu’au portail de la propriété.Une 206, qui a dû parcourir une bonne moitié de la distance séparant la Terre de la Lune, stationne à proximité de l’entrée et lorsque Marianne m’aperçoit, elle me fait un appel de phare accompagné d’un petit signe de la main.— Je me demandais si vous alliez venir, me dit-elle alors que j’ouvre la portière.— Vous m’auriez attendu ?Marianne jette un coup d’œil à l’horloge de la voiture avant de répondre :— Trois minutes, mais pas une de plus.Je souris.— Vous vous rendez compte que vous allez emmener un symbole du capitalisme local au défilé annuel des syndicats des ouvriers.Marianne a un petit rire.— Rassurez-vous, je ne dirai pas à mes camarades que vous êtes un salaud de patron qui veut licencier la moitié de son personnel.La trentenaire rousse a malheureusement raison. Je n’ai pas été foutu de sauver ma boîte et des dizaines de personnes vont se retrouver sur le carreau. Mais, curieusement, c’est elle qui me remonte le moral.— Allons ! Oubliez vos soucis pendant trois jours. De toute façon, vous savez comme moi qu’on ne peut pas lutter contre des pays où les employés bossent cinquante heures par semaine pour moins de cent euros par mois.Je souris à mon tour avant de lâcher :— Voilà un discours qui plairait beaucoup aux actionnaires du monde entier.Marianne me fait un clin d’œil puis elle se concentre sur sa conduite.— On en a bien pour trois heures de route. Reposez-vous. Vous me relaierez à mi-parcours.J’entends à peine la fin de sa phrase, car je m’endors comme une masse.####— Le plein est pour moi, dis-je lorsque j’émerge alors que la voiture vient de s’immobiliser au niveau d’une pompe de station service.Après avoir payé l’essence, je rejoins Marianne à une table haute sur laquelle elle a posé deux grands cafés en attendant que je la rejoigne. En m’approchant, je l’examine longuement et j’ai l’impression de la regarder pour la première fois. Ce que je découvre me procure un sentiment très agréable. De taille moyenne, Marianne est sans conteste une jolie femme dont les vêtements tout simples laissent deviner une adorable paire de seins haut perchés, des fesses rondes et fermes surplombant des jambes admirablement fuselées et musclées sans excès.Son air mutin et le sourire joyeux qui illumine son visage me procurent une joie discrète que j’ai bien du mal à éprouver en cette période problématique.— Que se passe-t-il, Gontran ? Vous avez l’air tout chose. Ne me faites pas faux bond. Si j’ai laissé ma place dans un car confortable pour prendre ma vieille bagnole cabossée, c’est parce que j’espérais bien trouver un chauffeur de secours.Il me faut quelques secondes pour redescendre sur terre.— Bien sûr Marianne. Vous pouvez compter sur moi. J’ai juste eu un court moment d’absence.###Alors que nous approchons de Paris, ma passagère me demande de bifurquer vers l’A86.— Nous allons parquer la voiture à proximité de l’immeuble de mon frère, à Saint-Denis. Il nous attend avec une petite collation. Ensuite, nous nous rendrons jusqu’au métro pour rejoindre la place de la République à Paris, point de départ de la manifestation.Je me laisse guider jusqu’à l’emplacement indiqué puis, une fois le véhicule garé, je m’extrais de la 206 en même temps que Marianne qui m’emmène jusqu’à l’entrée d’un bâtiment sans charme et de médiocre construction. Les grands immeubles qui nous entourent m’oppressent un peu et ma déléguée du personnel s’en rend compte.— Rassurez-vous Gontran, nous ne sommes pas dans le Bronx. Tout va bien se passer.###Alors que nous tentons de nous frayer un chemin dans la foule disparate et bigarrée, je vois Marianne faire un grand signe de main à des quidams que je ne peux situer. Une minute plus tard, nous sommes rejoints par un joyeux groupe dont les membres arborent fièrement des écharpes de la CGT. Marianne étreint chaleureusement le plus âgé avant de se tourner vers moi.— Viens me dit-elle, je vais te présenter la fine équipe.Je me garde bien de faire une quelconque allusion au soudain tutoiement de mon employée qui s’apprête à effectuer ses civilités.— Ce beau jeune homme ici présent, m’explique-t-elle en me montrant le solide gaillard qu’elle vient de serrer dans ses bras, n’est autre que Momo, le frère cadet de ma mère et tous ceux qui l’accompagnent aujourd’hui sont les membres de la section syndicale qu’il anime avec passion depuis plus de vingt ans.Je fais donc connaissance dans la foulée avec Bernie, Akim, Claudie, la Meule, Riton, Pedro et Marie-No avant que l’oncle Momo s’adresse à sa nièce :— Et c’est qui ce godelureau que tu nous amènes aujourd’hui ? On dirait qu’il a avalé son parapluie.La remarque fait bien rigoler l’assistance qui me regarde avec un soupçon de méfiance. Je n’ai donc pas le choix et je me présente à mon tour.— Bonjour à tous, sachez que je me prénomme Gontran, que je travaille dans l’entreprise de Marianne et que je suis ravi de rencontrer ses amis par cette belle journée.— Gontran, comme le cousin de Donald, lâche Riton, le lettré de la troupe, en s’esclaffant.— En effet, dois-je reconnaître de mauvaise grâce.Heureusement, Marianne vole à mon secours en s’adressant à ses camarades.— Bon, les copains, c’est vrai qu’il a l’air un peu coincé, mais il ne faut pas en vouloir à Gontran, c’est la première fois qu’il participe au défilé du premier mai.À ce moment-là, Momo s’approche de moi, m’enserre dans ses bras et me congratule avec énergie au risque de me broyer quelques côtes.— Ça me réchauffe le cœur de voir qu’il existe encore des salariés prêts à défendre les intérêts de la classe ouvrière, lâche-t-il les yeux embués de reconnaissance avant de m’achever.— Tu verras, Gontran, ces salopards de capitalistes vont finir par nous la vendre, cette corde qui servira à les prendre.Marianne a du mal à ne pas éclater de rire en voyant ma mine déconfite. Heureusement, la tête du cortège s’anime enfin et nous nous apprêtons tous à suivre les leaders qui déclament avec conviction les slogans et les justes revendications des travailleurs.####Nous progressons depuis plus de trois quarts d’heure, immergés dans un flot humain discipliné constitué de plusieurs dizaines de milliers de personnes. J’avoue que l’ambiance bon enfant qui émane de cette foule est communicative et je suis enclin à partager la joie simple de mes voisins. Je ne vais pas jusqu’à entonner les chants révolutionnaires avec les manifestants, mais je suis touché malgré moi par l’espérance véhiculée par cette procession baignée par un soleil quasiment estival.Ayant remarqué mon air béat, Marianne m’adresse un magnifique sourire avant de glisser son bras sous le mien et de se coller contre moi. Je suis plus ému qu’un collégien qui se rend à son premier rendez-vous amoureux et un frisson délicieux irradie le bas de mon dos.La jolie rousse me fait un nouveau clin d’œil et je ne peux m’empêcher de passer mon bras autour de sa taille. Marianne s’approche un peu plus de moi et j’ai bien du mal à maîtriser la raideur qui gagne mon caleçon. N’y tenant plus, je lui murmure à l’oreille.— Je ne voudrais pas briser cette ambiance joyeuse et revigorante, mais j’ai une folle envie de vous embrasser.Marianne éclate de rire, prend ma main et m’attire sur le côté du défilé. Elle me regarde les yeux pétillants de malice et déclare :— Bon alors ? Qu’est-ce que tu attends ? Face à ce visage d’une fraîcheur désarmante, j’oublie le monde entier et j’enlace Marianne dans mes bras pour mieux plaquer mes lèvres sur sa jolie bouche.Il y a bien longtemps que j’ai pas vibré à ce point lors d’un échange de salive avec une personne du sexe opposé. Je voudrais que cet instant ne s’arrête jamais. Ce baiser délicieux vide mon esprit de tous mes déboires financiers et personnels. Seule Marianne m’importe alors et nous profitons de la fin du défilé pour nous peloter et nous embrasser comme deux ados immatures.###L’accueil de Vincent, le frère de Marianne, et de sa famille n’a d’égal que la gentillesse de Nadia, son épouse, qui a cuisiné une bonne partie de la journée pour nous offrir un dîner de gala.Son couscous est le meilleur que j’ai jamais mangé, même si j’admets volontiers que ce plat est loin de faire mon ordinaire. Vincent est heureux de nous servir du Boulaouane pour accompagner le repas, ce qui donne une occasion à Marianne de me chambrer un peu en prétendant que le vin que je consomme ordinairement tient plus du cru classé bordelais que de l’aimable piquette servie par sa famille.Alors que je suis prêt à faire honneur une nouvelle fois à la recette de Nadia, c’est Marianne qui me rappelle à l’ordre en expliquant à sa belle-sœur, avec un naturel désarmant, que ses projets pour la suite de la soirée ne sont pas forcément compatibles avec une consommation excessive de calories.Message parfaitement reçu, même si j’ai du mal à imaginer où nous allons pouvoir mettre en pratique ces fameux projets.C’est Vincent qui nous met au courant dans la foulée.— Bien entendu, nous vous avons laissé notre chambre à disposition, déclare-t-il à sa sœur.Ne me laissant pas le temps de protester, il ajoute aussitôt à mon attention.— Nous avons l’habitude de dormir dans le canapé-lit. C’est pour cette raison que nous n’avons pas lésiné sur la qualité lorsque nous l’avons acheté. La famille c’est sacré et il nous semble normal de remercier ceux qui défilent pour offrir un monde meilleur aux damnés de la terre.Je ne peux m’empêcher de penser que si mon grand-père paternel me voit en ce moment, il va sans aucun doute se retourner dans sa tombe.####Faire l’amour avec Marianne me semble aussi naturel que respirer. Lorsqu’elle prend mon sexe en bouche pour me sucer, avec une envie plaisante à voir, sa langue agile devient une voluptueuse caresse qui se plaque sur ma hampe et en aspire la tête, faisant jaillir une source qui libère mille perles de muguet dans sa gorge gourmande.Alors à mon tour, je tète son bourgeon qui s’ouvre tel une tulipe arrogante libérant le plaisir qui l’entraîne dans un tourbillon déchaîné.Mais, bien sûr, mes assauts ne sauraient s’arrêter à cette première explosion des sens et le corps à corps ne cesse que lorsque mon étendard fièrement dressé investit dans un ultime effort l’entrée de service de la belle Marianne, commémorant à ma façon le 14 juillet 1789 dans une prise pacifique, sinon pacifiée, de la pastille prolétarienne.Tout conjugue le verbe aimer. Voici les roses.Je ne suis pas en train de parler d’autres choses.Premier mai ! l’amour gai, triste, brûlant, jaloux,Fait soupirer les bois, les nids, les fleurs, les loups ;L’arbre où j’ai, l’autre automne, écrit une devise,La redit pour son compte et croit qu’il l’improvise.Ces vers de Victor Hugo me reviennent à l’esprit alors que ma maîtresse repue de plaisir dort profondément, le visage rayonnant, blottie au creux de mes bras.J’éprouve ce sentiment unique et fusionnel si rare qui survient lorsque un plus un fait toujours un et que le tout est supérieur à la somme des parties.####Le traitement administré par Marianne a fait des miracles. Il y avait des mois que je n’avais pas dormi d’une aussi longue traite et lorsque j’émerge enfin de cette nuit revigorante, la jolie rousse est aussi ravie que moi de constater, malgré notre intense activité de la veille, la raideur matinale de mon membre viril qu’elle s’empresse d’emboucher avec un enthousiasme communicatif. Mais point de turlutte finale, car nous voilà repartis pour une heure d’exercice horizontal, alternant les séquences lentes et les chevauchées rapides, comme des adeptes confirmés de ces disciplines mixtes que les salles de sport ne cessent de décliner à destination de leurs abonnés.C’est Nadia qui nous rappelle à l’ordre vers onze heures quinze, alors que son mari rentre du parc où il a conduit les enfants dès que les gémissements de Marianne ont commencé à résonner dans l’appartement.Étendu sur le matelas, les bras en croix, je récupère de notre séance épuisante.— Alors patron, on rend les armes ? lâche Marianne hilare.— En effet, je ne peux que m’incliner face à la résolution des travailleurs.— Pas si vite, camarade. Nous n’avons pas fini d’exposer nos revendications. Il va falloir reprendre des forces, car cette après-midi, une nouvelle session de négociations va débuter.En voyant mon air éberlué, Marianne éclate de rire.— Une douche nous fera le plus grand bien. Ensuite, on s’habille, on mange un morceau et on repart pour une destination inconnue.— Que veux-tu dire ?— Je t’expliquerai.###Après une autre collation, nous avons quitté la famille accueillante du frère de Marianne et nous roulons désormais vers le sud, direction le Morvan. Ma déléguée du personnel préférée a prévu une visite à son oncle, paternel cette fois-ci, éleveur de brebis et producteur de fromage dans cette belle région.L’endroit est en effet bien paumé, à distance respectable de l’autoroute, et la petite ferme du maître des lieux tout à fait charmante. Le soleil déclinant illumine délicatement le décor champêtre et la bergerie est suffisamment éloignée pour que les effluves des occupants ne viennent pas chatouiller nos narines.Le gaillard qui nous accueille avec un franc sourire respire le bon vivant par tous les pores de son teint rougeaud tanné par le soleil. Il s’adresse à moi avec une voix enjouée teintée d’un accent rocailleux.— Dis donc, gamin, ça fait un siècle que la Marianne n’est pas venue me voir en galante compagnie. J’espère qu’elle s’est pas trompée de bonhomme en te ramenant chez moi, parce que sinon tu peux numéroter tes abattis.Je m’abstiens d’expliquer à l’oncle André que notre histoire amoureuse a moins de quarante-huit heures et que l’annonce des fiançailles n’est pas encore dans la road map. Je me contente de lui serrer la main en prenant garde à ce qu’il me laisse l’usage de mes phalanges.Le temps de déposer nos bagages dans une chambre au décor simple, mais accueillant, puis de nous désaltérer rapidement, et nous laissons tonton vaquer à ses tâches pour aller explorer le royaume de Marianne.— Vois-tu, me dit-elle, mon oncle va bientôt prendre une retraite méritée pour aller s’installer au bord de la mer.— Ah bon ? demandé-je, il possède une résidence secondaire ?Ma question déclenche un grand éclat de rire chez ma compagne.— On peut dire ça. En fait, il s’agit d’une petite cabane en bois, plantée au milieu d’un terrain grand comme un mouchoir de poche, mais qui dispose d’une vue incroyable sur la mer. Tonton André ne me parle que de ce projet à chaque fois que je viens le voir.— Qu’est ce qui l’empêche de vendre son exploitation et partir s’installer dans son palace alors ?— C’est moi.— Comment ça ?— Peu après mon divorce, j’ai eu le malheur de lui dire que je lui succéderais lorsqu’il partirait à la retraite. Et il s’accroche à cette idée comme un malheureux.— C’est vraiment ton projet ?— C’était plutôt un fantasme, mais maintenant que je sais que mon emploi actuel est fortement compromis, je me demande : pourquoi ne pas franchir le pas ? D’autant plus qu’avec la prime de licenciement, le chômage et quelques subventions perçues à droite et à gauche, je pourrais prendre le temps de vérifier mes capacités et ma motivation sans trop m’inquiéter pour les fins de mois. André est en outre d’accord pour attendre que l’argent rentre avant que je commence à le rembourser.Je regarde Marianne avec circonspection.— Tu as les compétences pour assurer l’activité de l’exploitation ?— Depuis mon plus jeune âge, j’assiste mon oncle à chaque fois que je séjourne ici et je peux te dire que j’ai passé la plupart de mes congés d’été dans cet endroit.— Admettons, mais tu t’imagines vraiment vivre ici, à l’écart de tout et du monde ?Marianne serre alors ma main et se blottit contre moi avant de répondre.— Évidemment, ce serait plus confortable si je rencontrais un homme charmant prêt à me soutenir et à partager ma nouvelle vie.Nous regardons, silencieux, dans la même direction. Le soleil décline lentement et les vers magnifiques de Victor Hugo viennent à nouveau s’immiscer dans mon esprit :L’atmosphère, embaumée et tendre, semble pleineDes déclarations qu’au Printemps fait la plaine,Et que l’herbe amoureuse adresse au ciel charmant.A chaque pas du jour dans le bleu firmament,La campagne éperdue, et toujours plus éprise,Prodigue les senteurs, et dans la tiède briseEnvoie au renouveau ses baisers odorants ;Tous ses bouquets, azurs, carmins, pourpres, safrans,Dont l’haleine s’envole en murmurant : Je t’aime !Sur le ravin, l’étang, le pré, le sillon même,Font des taches partout de toutes les couleurs ;Et, donnant les parfums, elle a gardé les fleurs ;Comme si ses soupirs et ses tendres missivesAu mois de mai, qui rit dans les branches lascives,Et tous les billets doux de son amour bavard,Avaient laissé leur trace aux pages du buvard !Les oiseaux dans les bois, molles voix étouffées,Chantent des triolets et des rondeaux aux fées ;Tout semble confier à l’ombre un doux secret ;Tout aime, et tout l’avoue à voix basse ; on diraitQu’au nord, au sud brûlant, au couchant, à l’aurore,La haie en fleur, le lierre et la source sonore,Les monts, les champs, les lacs et les chênes mouvants,Répètent un quatrain fait par les quatre vents.