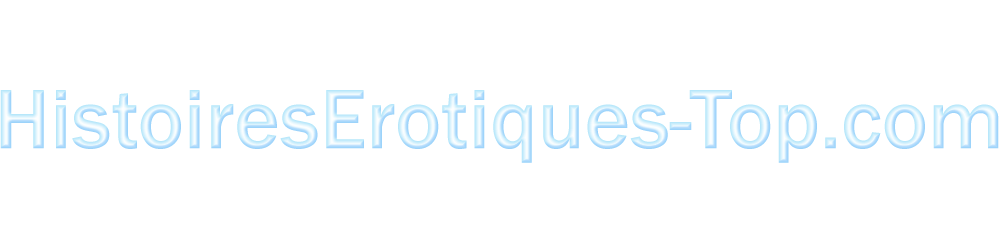Camp Hardy, 6 juillet 1960Le capitaine-commandant Gilles LeBlanc fut bombardé commandant de Camp Hardy, les mutins apaisés l’ayant choisi pour remplacer le colonel, dont ils avaient exigé le départ avec véhémence, tout comme le départ du major.Ce furent donc lui et un capitaine, lui aussi jugé « bon officier » par la troupe, qui assumèrent le commandement. Au total, environ la moitié des officiers de Camp Hardy furent chassés, tandis que l’autre moitié — surtout ceux qui avaient de jolies filles — furent « gentiment invités » à rester.Gilles LeBlanc craignait pour la sécurité des siens, et chercha à les faire évacuer, mais les gardes veillaient au grain : aucun Blanc n’était plus autorisé à sortir de Camp Hardy. Le capitaine-commandant Gilles LeBlanc le savait bien, les officiers blancs et leurs familles étaient gardés comme otages. Il lui fut d’ailleurs interdit de porter des armes, à lui comme à tous les autres Blancs.Comme par une curieuse coïncidence, les officiers célibataires furent tous chassés sans exception, mais les femmes civiles comme mademoiselle Christiaens et Virginie Longin, qui étaient parvenues à rejoindre le mess des officiers à temps, furent toutes obligées de rester.Les soldats de la Force publique du Congo étaient rois et maîtres. La confiance régnait, et seuls les plus naïfs et les imbéciles continuaient de croire que toute cette histoire finirait bien.Jeudi, 7 juillet 1960. L’ordre était rétabli à Camp Hardy, mais le capitaine-commandant Gilles LeBlanc ne savait plus trop quoi faire.Toutes les lignes téléphoniques des officiers étaient sous écoute, il n’en doutait pas. Il ne pouvait pas non plus envoyer de télégrammes, car cela aussi était passé au crible. Il ne pouvait pas davantage envoyer de messages cryptés; c’est qu’il avait lui-même formé de ses hommes dans le cryptage et le déchiffrage de messages; il les avait d’ailleurs très (trop) bien formés.Trois adjudants vinrent à son bureau, c’est-à-dire celui de l’ex-commandant, le colonel, dont la femme était hospitalisée, en train de se remettre péniblement de son calvaire.Les trois adjudants s’excusèrent pour les violences et les brutalités commises par leurs hommes. Ils insistèrent pour dire qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de faire du mal aux officiers et à leurs familles, mais ils avaient jugé nécessaire d’envoyer un message fort.Ils promirent solennellement qu’on ne toucherait plus à aucun Blanc à Camp Hardy, aussi longtemps qu’officiers et sous-officiers blancs, de même que les spécialistes civils, montreraient leur bonne volonté en restant avec leurs familles.« Je vois, » répondit-il. « Bon, alors je puis me fier à votre parole, Messieurs. »Le commandant intérimaire les fit alors sourire en blaguant… « Messieurs, j’ai ouï-dire que tous les soldats congolais vont être promus d’un grade, avec augmentation de solde correspondante. Et puisque la mesure ne s’applique pas à moi, je crois bien qu’il va me falloir attendre encore quelques années avant ma promotion de major. »Le climat était tendu; il faisait de son mieux pour calmer le jeu, en étant poli et en les appelant « Messieurs », du jamais-vu venant d’un officier s’adressant à des sous-officiers.Pour l’heure, c’était encore possible de calmer la crise pacifiquement juste assez longtemps pour que lui et sa famille puissent rentrer en Belgique. Sa plus grande crainte venait de Bruxelles : si l’état-major métropolitain envoyait un trop fort contingent de troupes belges, cela enragerait le gouvernement et l’armée du Congo, auquel cas tout incident sérieux, toute escarmouche avec effusion de sang, ferait sauter la poudrière. De nouvelles mutineries éclateraient partout, et cette fois plus rien n’arrêterait les mutins en colère, car c’était eux à présent qui contrôlaient l’accès aux armes! Tout le Congo s’embraserait.À la radio, le premier ministre Lumumba annonça à la nouvelle nation qu’il avait limogé le général Janssens et que chaque soldat congolais était promu d’un grade avec effet immédiat. Il tâchait par tous les moyens de calmer les troupes agitées. La chose qu’il omettait de dire, c’est qu’il avait congédié le colonel belge qui dirigeait la sécurité intérieure et l’avait forcé à retourner dans la Métropole, précipitant l’effondrement de toute l’organisation, déboires auxquels s’ajoutait le départ du plus gros des fonctionnaires blancs, qui avaient pris le premier billet pour Bruxelles, morts de peur pour eux-mêmes et leurs familles.Vendredi, 8 juillet 1960. La situation à Léopoldville se détériora brusquement en avant-midi, quand le centre-ville fut littéralement pris d’assaut par des mutins, à présent lourdement armés, venus de Camp Léopold. C’est qu’il circulait une rumeur selon laquelle des troupes soviétiques étaient sur le point d’atterrir à l’aéroport avec le soutien de Bruxelles.Un bataillon congolais dépêché sur les lieux pour en avoir le cœur net retourna immédiatement au centre-ville; les soldats commencèrent à arrêter des voitures pour fouiller les véhicules et toutes les personnes européennes, à la recherche d’armes. Quelques exactions furent commises.Une journaliste ouest-allemande se retrouva les seins nus. Elle tenta d’échapper au pire par sa présence d’esprit, en racontant la légende d’une Lorelei sanguinaire, pire que les sirènes et dont l’esprit animait ses cheveux roux. Les soldats invectivèrent la Munichoise rousse, qu’ils finirent de déshabiller complètement et plaquèrent face première contre le capot de sa voiture avant de l’embrocher sans vergogne. On la fit braire comme une truie en la violant dans le cul pour lui montrer que les Congolais n’étaient pas des crétins.Vers 9 h 30, les soldats avaient fermé le port, paralysant le traversier et empêchant les réfugiés de passer à Brazzaville, tandis que d’autres mutins occupèrent le central téléphonique, où quelques téléphonistes furent violées. D’autres encore bloquèrent la route de l’aéroport, autorisant quelques automobilistes à passer moyennant paiement en nature.Le centre-ville grouillait de soldats de la Force publique. À pied, en camion ou en jeep, ils patrouillaient les rues, interpellant tout passant d’apparence européenne qu’ils apercevaient en prétendant être à la recherche d’officiers belges. Par ailleurs, des mutins investirent deux des plus gros hôtels de la capitale.Là, on trouva prétexte pour brutaliser des ressortissants européens; ils violèrent même deux chanteuses et une actrice américaines bien connues, dont l’identité resta un secret d’État. Un touriste canadien-français prit même des photos de sa femme pendant que des soldats la forçaient à tour de rôle; tout le monde riait et la jeune épouse catholique passa deux heures inoubliables à se faire brasser et frotter les seins d’un orgasme à l’autre.Un bataillon de soldats était convaincu, ou s’était lui-même convaincu que le premier ministre Lumumba faisait venir un fort contingent de troupes soviétiques en vue de désarmer la Force publique. Le bataillon de mutins en colère prit d’assaut le grand hôtel et mit à sac les chambres et les suites où logeait la délégation soviétique, notamment l’ambassadeur de l’URSS et sa famille, qui avaient assisté aux célébrations entourant la déclaration de l’indépendance, prononcée huit jours plus tôt.Des femmes et filles russes furent sauvagement déshabillées et violées par de très nombreux mutins qui hurlaient leur colère mêlée d’une brutale joie hormonale.Le trop-plein de nègres en uniforme se déversa dans le reste de l’hôtel; on fit du porte-à-porte, et l’on dégota à peu près tout ce que l’hôtel avait d’épouses et de filles au joli minois et aux cuisses blanches. Ces touristes avaient vu les défilés de l’indépendance; maintenant c’était les mutins qui défilaient dans leur chambre pour leur montrer une autre façon de célébrer l’indépendance.La troupe s’agitait partout à Léopoldville et dans un nombre croissant de régions, à mesure que se répandait la rumeur au sujet des soldats soviétiques. On soupçonnait les civils belges de s’armer. Il s’ensuivit des incidents où des soldats de la Force publique vinrent frapper chez des Blancs; ils firent des perquisitions « légales » lors desquelles ils saisirent toute arme trouvée sur les lieux. Ce fut bien entendu l’occasion de nouveaux actes de violence contre des ressortissants belges.De nombreux réfugiés et rescapés de cette chasse aux Blancs prirent la route à travers tout le pays, direction l’aéroport ou la Rhodésie, pays limitrophe au sud. La plupart de ces Blancs en fuite, dont certains s’étaient armés jusqu’aux dents, passèrent la frontière sans problème. Certaines familles eurent moins de chance et se firent piéger dans quelque secteur contrôlé par des mutins, et l’on vit des barrages routiers devenir le théâtre de viols collectifs en plein jour.Telle épouse flamande fut violée au bord du chemin, en pleine brousse, devant ses grands-parents. Tel grand frère assista, impuissant, au viol de ses sœurs pendant que d’autres soldats s’amusaient à sodomiser sa petite-amie et sa mère, près des deux voitures stoppées par un camion militaire sorti de nulle part, et qui assurément les attendait après avoir été prévenu par les soldats d’un barrage routier passé sans problème quelques minutes plus tôt; ces derniers avaient sauté dans leur jeep et rappliqué en vitesse pour avoir leur part du butin.Samedi, 9 juillet — Le premier ministre annonça solennellement que la Force publique devenait l’Armée nationale du Congo, et que son corps des officiers était africanisé : les grades de sous-lieutenant à général étaient désormais accessibles aux soldats congolais. La nouvelle Armée nationale aurait un commandant en chef et des officiers congolais. Au Président revenait le commandement suprême, et le premier ministre Lumumba restait ministre de la Défense.Quant aux officiers belges restant au sein de l’Armée congolaise, ils agiraient désormais en qualité de conseillers civils. Les mêmes conditions d’africanisation s’appliqueraient à la gendarmerie et à la police.À Camp Hardy, un adjudant Bobozo aux états de service exemplaires fut, du jour au lendemain, promu colonel et commandant de la garnison. Deux autres adjudants furent promus majors. Ainsi, les mêmes adjudants qui étaient passés voir le capitaine-commandant LeBlanc dans son bureau en tant que subordonnés deux jours plus tôt lui étaient désormais supérieurs en grade. Pire, lui n’était plus qu’un conseiller civil, obligé désormais de venir travailler en veston et cravate, et sans arme bien entendu!Le capitaine-commandant, vétéran de la retraite de Dunkerque, fit un effort surhumain d’humilité pour prendre la chose du bon côté, s’accrochant à l’espoir de fuir indemne, lui, sa femme et ses deux belles grandes filles.Mais c’est tout son univers qui s’écroulait sous ses pieds. Chaque nouveau jour amenait son lot d’événements impensables; il allait de surprise en surprise. Il sentait qu’il n’était plus que le jouet d’une immense tempête politique, avec le risque de devenir un pion sacrifié.D’autres officiers le prirent très mal. Ils faisaient beau visage au nouveau colonel de couleur, mais ils bouillaient de colère! Ils étaient outrés de se retrouver dindon d’une farce grotesque. Quel cirque! Ils espéraient voir des troupes belges débarquer en masse au Congo pour écraser ce qu’ils voyaient comme une rébellion.Gilles LeBlanc leur rappela que la violence n’était pas la solution dans ce cas-ci. Songeaient-ils à leurs familles ici à Camp Hardy et à ce qui risquait de leur arriver en cas de mutinerie totale? La garnison comptait à présent seulement 55 officiers blancs contre 3 000 soldats congolais.Il fallait gagner du temps, jusqu’à ce qu’ils trouvent un moyen de foutre le camp et de sauter dans le premier vol pour Bruxelles. Le Congo était d’ores et déjà perdu pour la Belgique. Ne le comprenaient-ils pas? La violence avait éclaté aux quatre coins du pays; le lien de confiance était rompu; il n’existait plus d’endroit sûr. La plupart des fonctionnaires avaient pris ou prenaient la poudre d’escampette, laissant tout l’appareil étatique désorganisé sans retour, faute de personnel dûment formé.Les officiers blancs n’avaient plus qu’une seule planche de salut : partir, et en vitesse. Seulement, toutes les issues étaient sous forte garde, surtout depuis que le colonel Bobozo avait été bombardé commandant. On aurait dit qu’il veillait très jalousement sur ses prisonniers et guettait la première occasion de profiter de la situation.Pendant la nuit du 9 au 10 juillet, deux capitaines tentèrent de s’évader de l’enceinte du camp, de nuit, avec leurs femmes, un fils de vingt ans et une fille de deux ans plus jeune. Ils envisageaient de courir à Thysville, d’où ils téléphoneraient à des amis de Léopoldville qui viendraient les chercher.Leur plan échoua, et ce fut tant mieux pour leurs amis de Léopoldville, qui se seraient sans doute fait cueillir à un barrage routier, car le colonel Bobozo n’était pas un idiot; il tenait serré son double périmètre autour du camp, périmètre qu’il appelait affectueusement « grandes lèvres » et « petites lèvres » en songeant à Juliette LeBlanc, qu’il comptait s’offrir à la première occasion. Il laisserait sa sœur Anne aux deux majors.Les deux capitaines crurent la voie libre, mais les gardes se tenaient cachés et communiquaient en faisant des bruits d’oiseaux de nuit.Le sergent donna un grand coup d’air à son sifflet et les fuyards blancs furent aussitôt encerclés et mis en joue par sept soldats, dont certains braquaient leur lampe de poche sur eux et les éblouissaient de cette lumière soudaine.D’autres soldats accoururent, ameutés par le bruit. La jeune fille et les épouses furent tout de suite remarquées et sifflées par la troupe. Les deux officiers pris en faute furent traités de mauvais Blancs et roués de coups de crosse. Le fils de 20 ans tenta stupidement de se défendre, frappa un soldat d’un solide direct, puis fut dangereusement rossé par trois ou quatre soldats qui le frappèrent de leurs bottines et de leurs crosses de fusil jusqu’à ce qu’il fût étendu, presque inconscient, avec le visage tuméfié, un œil en train de se fermer sous l’enflure et des plaies ouvertes saignant abondamment.Le jeune homme salement amoché n’eut pas moins le plaisir immoral d’une érection lorsqu’il entendit Laurence, la jeune fille qu’il courtisait, commencer à se faire attoucher par des Congolais qui s’attroupaient autour d’elle.Les deux épouses et la fille allaient être violées sur-le-champ et par toute la troupe, qui formait à présent un peloton d’une trentaine d’hommes.La jeune fille cria au meurtre et demanda poliment aux soldats d’arrêter quand ils lui déchirèrent son joli chemisier couleur safran qui rehaussait à merveille le châtain de ses cheveux ondulés, portés mi-longs. Son soutien-gorge fut pulvérisé par une main tribale et ses seins de jeune fille née à Gand apparurent sous les faisceaux des lampes de poche. Ses mamelons durcirent au contact de l’air frais, rehaussant la splendeur apeurée des seins en mouvement.Les sifflements et les remarques fusaient dans la soldatesque…« Oh, elle a de vrais beaux nichons, la petite Laurence! »« Allez les gars, on va tous la violer, cette petite chipie! »« J’ai hâte de voir son joli petit cul de Blanche! »« Arrachons-lui son pantalon… »« Hé, ma pouliche, fais voir ton joli petit cul… »« Et moi, foi de caporal Banza, je vais l’enculer devant son père! »« Je parie qu’il va aimer voir ça, le gros cochon! Et si on l’obligeait à violer sa fille? »« Ça, ce serait chouette! »« Allez vous autres, fermez vos gueules et déshabillez-moi cette trainée! » conclut le sergent.Déjà, les deux épouses belges, Joséphine et Sophie, étaient allongées par terre.Les soldats avaient précipitamment monté la jupe de Joséphine et lui avaient retiré sa petite culotte afin de voir si elle avait beaucoup de poils, qui seraient assurément foncés puisque Joséphine était une brune. Les rires gras et sifflets fusèrent quand on découvrit sa jolie touffe, qui formait un triangle net et invitant pour les soldats. Comme elle avait de tout petits seins, ils lui laissèrent son chemisier intact et commencèrent à la violer à tour de rôle.Sophie, qui avait la poitrine plutôt généreuse, eut le chandail lacéré de la lame d’un couteau, puis brutalement déchiré. Un gros soldat, qu’elle connaissait depuis sept ans, et qui était si bon et gentil d’ordinaire, lui arracha brutalement le soutien-gorge et plongea sa tête de nègre entre ses deux seins, qui formaient deux petites collines de chair, bien rondes, surmontées de mamelons aux larges aréoles, qui disparurent bien vite sous la bouche et les mains du gros soldat aux yeux ébahis. La beauté de ses seins lui valut un sursis de quelques minutes, avant qu’elle fût mise toute nue et violée sauvagement. La bite du gros soldat finit par la faire jouir.Mais c’est Laurence, la fille, qui avait surtout la cote. Maintenue debout au milieu des soldats, elle ne put réprimer un couinement d’excitation secrète lorsqu’elle sentit les lèvres charnues et les mains d’ébène se poser sur ses petits seins fermes. L’adolescente savait que son père et Roger la regardaient se faire déshabiller, elle protestait et suppliait qu’on ne lui fasse pas violence, mais les langues de soldats congolais sur ses petits mamelons pâles lui arrachaient de criants halètements qui lui valurent le titre officiel de salope blanche.Elle avait mis un pantalon blanc lui descendant à mi-mollets. Elle sentit l’air nocturne et frais lui caresser les pieds nus quand la brise souffla sur la scène de déshabillage qui marquait la fin de sa vie de jeune fille.Elle commença à pleurer comme une Madeleine quand le sergent, un grand gaillard bien bâti, lui ôta rapidement son pantalon et sa petite culotte. Elle avait voulu se garder vierge pour Rémi, le fils de Roger qui gisait à demi inconscient non loin de là. Elle avait prévu accéder à ses demandes, car elle le savait sincère et honorable. Elle avait rêvé de la nuit de noces où elle se donnerait enfin à lui, et il l’aurait à lui, tout entière, pour toujours; et elle l’aurait, lui…Ce rêve de virginité offerte au soir des noces fut brisé brutalement par la grosse bite du sergent, qui ria bien fort quand il sentit comme elle avait la chatte mouillée de s’être fait sucer les seins par la troupe.Rémi vit l’horreur de son seul œil ouvert quand le sergent entra en Laurence et commença à la violer, debout et lui empoignant puissamment le dessous des cuisses tandis que les soldats lui tenaient les bras et d’autres continuaient de lui caresser la poitrine.Maintenue tout contre le corps massif du sergent, Laurence fut éperonnée à répétition par sa grosse bite. Au début, la douleur fut cuisante, insupportable, puis les coups de boutoir devinrent étrangement agréables à recevoir pour son corps, mais horribles pour son esprit.Fascinée, Laurence n’arrivait pas à fermer les yeux; elle regardait sans cesse le large visage sombre du sergent Kongolo, qu’elle connaissait de vue et de nom. Son nez épaté, ses lèvres charnues et l’ivoire de ses dents attisaient son plaisir sauvage pendant qu’il la violait comme un taureau en laissant échapper de forts grognements.Les mains sur ses seins et les remarques grivoises des soldats, qui lui disaient tous comment ils allaient la violer, achevèrent de rendre son corps fou de plaisir, tandis que le sergent la labourait de ses solides coups de bélier.Laurence cria et jouit très fort au milieu des soldats; son corps l’obligea à serrer le sergent dans l’étau de ses jambes en pressant son sexe contre lui pour le prendre bien profond en elle. Les soldats lui dirent en riant qu’elle était la pire salope blanche de Camp Hardy.Elle aperçut sa mère Joséphine se faire violer en missionnaire, à côté de Sophie, que d’autres mutins tenaient presque à l’envers : un caporal la violait en lui soulevant les hanches tandis qu’elle était maintenue au sol, les épaules à plat.